mercredi, 20 août 2025
Le dîner des cons
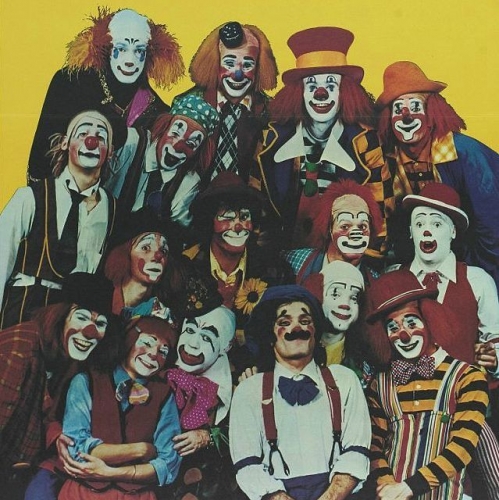
Le dîner des cons
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/la-cena-delle-beffe/
Un Trump rayonnant. Joyeux, presque enjoué. À la répartie facile.
Tel était l'image qu'offrait le président des États-Unis immédiatement après ses rencontres avec ses « alliés » européens. Et surtout avec l'Ukrainien Zelensky.
Qui, lors de la conférence de presse finale, en était presque à bégayer. Pour une fois en costume-cravate, à la demande de Trump, qui ne voulait pas d'un voyou en t-shirt camouflé à sa table.
Mais Zelensky tremblait. Et il était évident qu'il se raccrochait à tout pour ne pas perdre pied devant Trump. Qui souriait comme un chat qui vient de manger une souris. Ou qui se préparait à manger une tribu de souris d'élevage.
Oui, car Trump a obtenu le résultat qu'il s'était fixé. Remettre les Européens au pas, en montrant clairement qui commande pour de vrai. C'est Washington. Et le reste n'est que bavardages sans queue ni tête. Ils ne servent qu'à faire passer le temps.
Le magnat n'a même pas eu à faire d'efforts. Le bellicisme proclamé par Starmer, Macron, Merz, Rutte, von der Leyen s'est immédiatement révélé pour ce qu'il était en réalité. De vaines paroles. Dépourvues de toute substance réelle.
Et notre Meloni... tout simplement absente.

Sans les États-Unis, le reste de l'OTAN n'est qu'une mascarade sans substance. Bon pour faire un spectacle de cirque. Pas pour faire la guerre à la Russie.
Trump le savait, et il a agi en conséquence.
Le paradoxe est que, depuis son entretien amical avec Poutine en Alaska, il n'a rien obtenu. Pas la paix en Ukraine. Pas même un cessez-le-feu temporaire.
Le tsar négocie avec Washington. Et il déclare qu'avec Trump à la Maison Blanche, la fameuse « opération spéciale » n'aurait pas été nécessaire. Tout aurait été réglé par l'application des accords de Minsk.
C'est probablement vrai. Mais il est tout aussi vrai que ces accords sont désormais caducs. La Russie a gagné sur le plan militaire. Et elle entend maximiser le résultat en provoquant l'effondrement du régime de Kiev. Et, à tout le moins, à la neutralisation de l'Ukraine future. Si ce n'est à sa disparition pure et simple de la carte politique.
Quoi qu'il en soit, pour Zelensky, balbutiant en costume-cravate, c'est le glas qui sonne.
Le spectacle donné par les Européens est indigne. Après tant de déclarations, tant de polémiques, tant de menaces, ils se sont disputés pour essayer de s'attirer les faveurs de Trump. Un spectacle qui aurait dégoûté des prostituées s'offrant à leur client.
Trump riait sous sa moustache (qu'il n'a pas) et jouait, plaisantait, comme le maître d'un cirque sur le point de mettre aux enchères et de brader à l'abattoir des bêtes désormais abruties par leurs encagements.
Un dîner de la dérision. Avec un seul moment de vérité. Lorsque le président a déclaré, apertis verbis, qu'il était très satisfait de ces rencontres. Et qu'il en parlerait au téléphone avec Poutine. Immédiatement après.
Fin du jeu. Fin des plaisanteries. La politique internationale est une affaire sérieuse. Une affaire de grands.
Que les Européens se taisent et se mettent au pas.
14:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 août 2025
Trump accélère et élargit le découplage

Trump accélère et élargit le découplage
Leonid Savin
La décision de la Maison Blanche d'imposer des droits de douane à de nombreux pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine a eu un double effet. Certains ont accepté les nouvelles conditions avec toutefois certaines réserves, confirmant ainsi leur statut de satellite et de client des États-Unis. D'autres se sont indignés à juste titre de cette forme de néocolonialisme, et les plus fervents partisans du second camp ont déclaré être prêts à défendre leurs propres intérêts et à affirmer leur souveraineté, notamment par des mesures de rétorsion à l'encontre des États-Unis.
Deux d'entre eux sont des géants économiques et sont membres du Groupe BRICS: l'Inde et le Brésil. Si Washington a temporairement convenu avec la Chine, dont l'économie dépend clairement des États-Unis, de ne pas appliquer de sanctions sévères (auxquelles Pékin inclut sans aucun doute les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump), la situation est quelque peu différente dans le cas de ces deux pays. Et, selon toute vraisemblance, cette politique peu clairvoyante des États-Unis poussera Brasilia et New Delhi à prendre rapidement leurs distances avec leur récent partenaire dans les domaines les plus divers.

Dans le cas de l'Inde, les conditions imposées par les États-Unis se concentraient sur l'exigence de renoncer à l'achat de pétrole russe, ce que la partie indienne a judicieusement jugé irréalisable et a protesté.
Le 4 août, le gouvernement indien a publié une déclaration indiquant que « l'Inde a subi des pressions de la part des États-Unis et de l'UE pour acheter du pétrole russe... Alors qu'en réalité, l'Inde a commencé ces importations en provenance de Russie parce que les chaînes d'approvisionnement traditionnelles ont été rompues et redirigées vers l'Europe. Dans le même temps, les États-Unis ont activement soutenu les importations indiennes afin de renforcer la stabilité des marchés énergétiques mondiaux... Il est apparu que tous les États qui critiquaient l'Inde commerçaient eux-mêmes avec la Russie... En 2024, le commerce bilatéral entre l'UE et la Russie s'élevait à 67,5 milliards d'euros... Le commerce entre la Russie et l'UE comprend non seulement les ressources énergétiques, mais aussi les engrais, les minéraux, les produits chimiques, le fer et l'acier, les machines et les équipements de transport. Les États-Unis continuent d'importer de Russie de l'hexafluorure d'uranium pour leur industrie nucléaire, du palladium pour leur radioélectronique, des engrais et des produits chimiques... Les accusations portées contre l'Inde sont donc injustes et sans fondement. Comme toute grande économie, l'Inde prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts économiques et sa sécurité économique. »
Le 6 août, Trump a tout de même imposé des droits de douane de 25 % sur les produits indiens.
Il convient de noter que, relativement récemment, Apple a transféré sa production de smartphones de Chine vers l'Inde, ce qui a considérablement réduit le flux de gadgets en provenance de Chine vers les États-Unis, mais a augmenté le volume en provenance de l'Inde. Désormais, les consommateurs américains devront probablement payer plus cher, car le prix final inclura les nouveaux droits de douane. Il en va de même pour les autres produits expédiés de l'Inde vers les États-Unis, des médicaments (y compris les génériques) et l'électronique aux biens de consommation. Les exportations indiennes vers les États-Unis s'élèvent au total à environ 90 milliards de dollars par an. Leur réduction significative, qui est inévitable, obligera l'Inde à rechercher d'autres marchés, probablement en mettant l'accent sur les pays de la région afin de simplifier la logistique. Cependant, les consommateurs américains ressentiront très prochainement une hausse des prix ou une pénurie de produits indiens.

Au niveau politique, cela donne à l'administration de Narendra Modi, qui se présentait comme un ami personnel de Donald Trump, une raison de revoir d'autres accords avec les États-Unis, y compris le partenariat militaire – l'Inde est membre de l'alliance Quad, qui comprend également le Japon, l'Australie et les États-Unis. Les accords précédents dans le domaine des technologies critiques et de la coopération scientifique, qui avaient été annoncés en grande pompe, pourraient également être gelés.
L'Inde a déjà annoncé qu'elle renonçait à l'achat d'avions de combat polyvalents américains et qu'elle envisagerait très probablement une alternative russe, d'autant plus qu'elle a une longue expérience de coopération avec Moscou dans le domaine militaro-technique depuis l'époque de l'URSS. D'ailleurs, la Russie et l'Inde ont rapidement signé un nouveau paquet d'accords de coopération technique, ce qui témoigne de leur capacité à réagir rapidement à des mesures indésirables de la part de tiers. En outre, l'Inde a renoncé à acheter un lot supplémentaire de six drones lourds Boeing P-8A, l'annonçant ostensiblement dès l'introduction des droits de douane.

Mais surtout, la politique de la Maison Blanche pourrait modifier l'équilibre géopolitique en Asie du Sud. Washington ayant toujours considéré l'Inde comme un instrument pour contenir la Chine (et compte tenu de la taille et de la puissance de ce pays, il s'agissait d'un théâtre d'opérations opérationnel et stratégique), les relations entre les deux pays pourraient désormais se réchauffer sensiblement. Le Premier ministre Narendra Modi a déjà annoncé qu'il participerait personnellement au sommet de l'OCS en Chine le 31 août, où de nouveaux plans d'action pourraient être convenus pour coordonner les efforts conjoints de l'Inde et de la Chine (ainsi que de la Russie et d'autres membres de l'organisation) face à la pression américaine.
En Brésil, la situation est tout aussi intéressante et assez tendue.
Au sujet des nouveaux droits de douane, le président du pays, Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré qu'il existait une option concernant les métaux rares dans les relations avec les États-Unis, qui pourrait être utilisée dans les négociations. Dans d'autres déclarations, il a souligné que Washington n'effraierait pas le Brésil, car celui-ci commerce avec de nombreux pays. Mais le 4 août, il a vivement accusé les États-Unis de tenter d'organiser un coup d'État et a déclaré qu'il fallait trouver une alternative au dollar dans le commerce mondial.
Parallèlement aux discussions sur les nouveaux droits de douane, les États-Unis et l'UE ont imposé des sanctions contre le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes et son épouse, bloquant leurs comptes bancaires en Europe. Cette mesure a été prise dans le cadre de la loi dite « Magnitsky ». Washington voulait ainsi faire pression sur le Brésil dans l'affaire de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui a été assigné à résidence et dont les téléphones portables ont été confisqués. En réponse, les États-Unis ont imposé une nouvelle interdiction, retirant les visas de tous les membres de la Cour suprême brésilienne. Le site web du président américain a également publié un message faisant état de menaces présumées de la Brésil à l'encontre des États-Unis (un message similaire a été publié à propos de la Russie).
Dans le même temps, Lula da Silva a déclaré que les entreprises technologiques américaines ne pourraient plus travailler au Brésil si elles ne respectaient pas la législation de leur pays. La référence est plus qu'évidente.
Il est révélateur que, dans ce contexte, la compagnie aérienne brésilienne GOL ait annoncé le lancement de vols réguliers entre São Paulo et Caracas, malgré les sanctions américaines contre le Venezuela et les restrictions précédemment imposées à son voisin.
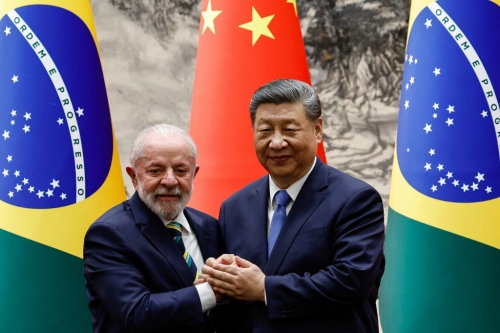
Enfin, Lula a déclaré que les pays du BRICS devaient élaborer conjointement une stratégie pour contrer les mesures unilatérales des États-Unis afin de protéger leurs intérêts.
Une telle coopération reflétera sans aucun doute l'esprit de multipolarité et démontrera une véritable ouverture dans le commerce et la coopération économique entre les pays et les régions, contrairement aux tentatives grossières des États-Unis de rétablir leur hégémonie unipolaire, si ce n'est par la force militaire, alors par des mécanismes géoéconomiques, ce qui équivaut à une guerre par d'autres moyens.
17:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : donald trump, tarifs douaniers, brics, brésil, inde, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 août 2025
Trump et Poutine: pourquoi l'Alaska?

Trump et Poutine: pourquoi l'Alaska?
Par Elena Fritz
Source: https://www.compact-online.de/trump-und-putin-warum-gerad...
L'Alaska, justement, pourrait-on dire en référence à un titre de film célèbre. Le lieu du sommet entre Trump et Poutine n'a pas seulement été choisi pour sa valeur symbolique, il revêt également une dimension stratégique.
Dans l'édition COMPACT « Vladimir Poutine : l'histoire de la Russie », vous en apprendrez davantage sur son agenda géopolitique ancré dans l'histoire, traduit en allemand. Pour en savoir plus: https://www.compact-shop.de/shop/sonderausgaben/edition-1....
Le choix de l'Alaska comme lieu du sommet du 15 août n'est pas un hasard. C'est l'État américain le plus proche de la Russie sur le plan géographique et historique, avec un message implicite: « Loin de tout le monde, surtout de l'UE ». Politiquement ancré dans le camp républicain et loin des réseaux mondialistes, des services secrets britanniques ou des structures de lobbying ukrainiennes, l'Alaska offre une occasion rare de mener des discussions sensibles sans fuites ni provocations ciblées.
Il est également idéal en termes de sécurité : survol minimal de territoires étrangers, contrôle maximal de l'environnement.
L'Arctique, clé stratégique
L'Alaska n'est pas seulement un symbole, il représente également la dimension arctique de la politique mondiale. En mai dernier, le Conseil européen des relations étrangères avait déjà mis en garde contre le fait que Moscou pourrait utiliser l'Arctique comme terrain de négociation avec Washington.

Un scénario spéculatif, mais digne d'intérêt: une limitation de la présence chinoise dans l'Arctique en échange d'un soutien moindre des États-Unis à Kiev. Une chose est claire: l'Arctique n'est pas seulement un gisement de matières premières et une route maritime, il fait partie de l'équilibre mondial des forces entre les États-Unis, la Russie et l'Europe.
Signaux antérieurs et ligne de conduite de Trump
Février 2025, Riyad : un diplomate russe basé au Canada était également présent à la table des négociations russo-américaines, ce qui indique clairement l'importance accordée à l'Arctique. Dans le même temps, Trump a annoncé son intention de rattacher le Groenland aux États-Unis et d'intégrer davantage le Canada.
Cela prolongerait considérablement la côte arctique américaine et intensifierait la concurrence pour le plateau continental arctique. Contre-argument de la Russie : la dorsale de Lomonossov, qui étaye ses propres revendications sur une grande partie du plateau continental arctique.

Perspectives
La rencontre en Alaska est plus qu'une simple discussion sur l'Ukraine. Elle s'inscrit dans le cadre d'un redécoupage de l'architecture du pouvoir mondial, avec l'Arctique comme monnaie d'échange potentielle, accompagnée de questions relatives au contrôle des armements, à la stabilité stratégique et à l'énergie. À Anchorage, un dialogue pourrait s'engager qui profilera non seulement les deux présidents, mais façonnera aussi l'ordre mondial à venir.
Plus important que jamais : ne lisez pas sur Poutine, mais lisez-le lui-même ! Dans l'édition COMPACT « Vladimir Poutine : l'histoire de la Russie », vous en apprendrez davantage sur son programme géopolitique ancré dans l'histoire, traduit en allemand. Le président russe dans ses propres mots. Commandes: voir lien supra.
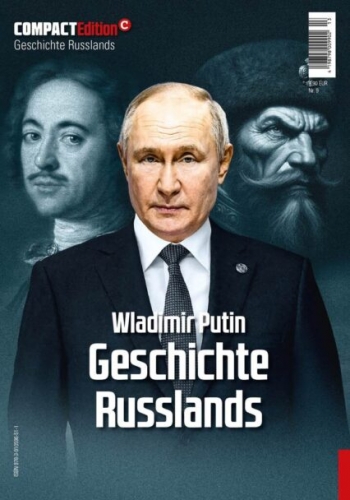
18:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alaska, actualité, donald trump, vladimir poutine, états-unis, russie, diplomatie, arctique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 août 2025
La politique douanière de Trump contre l'Inde: catalyseur pour les BRICS

La politique douanière de Trump contre l'Inde: catalyseur pour les BRICS
Par Elena Fritz
Source: https://www.compact-online.de/trumps-zollpolitik-gegen-in...
Le gouvernement de New Delhi ne veut pas se laisser dicter sa politique commerciale par les États-Unis. Cela conduit involontairement à un renforcement des pays BRICS et de la multipolarité. Pour savoir comment nous sommes pris en tenaille, lisez « Der hybride Krieg gegen Deutschland » (La guerre hybride contre l'Allemagne), le nouveau livre de cet auteur à succès qu'est Gerhard Wisnewski. Pour en savoir plus : https://www.compact-shop.de/shop/neu/gerhard-wisnewski-hy... .
La menace publique proférée par le président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 50% à l'Inde si celle-ci ne renonce pas aux matières premières russes est un événement de politique étrangère aux conséquences considérables, qui porte bien au-delà du cadre bilatéral.
Ce qui ressemble à première vue à un conflit commercial s'avère, à y regarder de plus près, s'inscrire dans une dynamique stratégique qui rapproche les pays du Sud. Au centre: l'Inde, et avec elle les pays du BRICS.
Une attaque qui conduit à un regroupement
Le point de départ : depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde importe de grandes quantités d'énergie russe à prix réduit, non seulement pour son propre approvisionnement, mais aussi pour la revendre sur le marché mondial par l'intermédiaire de négociants tiers.
Pour Washington, c'est un affront. Le président américain Donald Trump reproche non seulement à l'Inde de tirer profit des sanctions occidentales, mais la menace aussi ouvertement de représailles sous la forme de droits de douane de grande ampleur. Il associe cette menace à d'autres exigences: renoncer aux avions de combat russes, augmenter les commandes d'armes américaines et ouvrir le marché indien aux produits agricoles américains.
Mais la tentative de mettre sous pression publique cette économie émergente se heurte à des réalités culturelles et géopolitiques qui échappent à la logique habituelle du modèle américain. L'Inde ne se considère pas comme un bénéficiaire, mais comme un acteur à part entière dans un ordre multipolaire.
Delhi réagit avec calme stratégique
La réaction de New Delhi est prudente, mais claire. Au lieu de miser sur la confrontation ou de se justifier publiquement, l'Inde réagit par un geste diplomatique: le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval se rend à Moscou. Officiellement, il s'agit de questions de politique énergétique et de sécurité, mais officieusement, il s'agit également de coordonner les positions stratégiques au sein des BRICS. Le fait que cette visite ait été rendue publique peut être interprété comme un message clair: l'Inde agit de manière souveraine, et non dans l'ombre de Washington.
Dans le même temps, Delhi signale que ses propres décisions en matière de politique étrangère ne sont pas prises à la Maison Blanche, même sous un président républicain qui agit avec des moyens de pression bilatéraux plutôt que multilatéraux.
L'autonomie stratégique plutôt que la loyauté envers une alliance
Depuis des années, l'Inde poursuit une politique dite d'autonomie stratégique. Cela signifie une coopération étroite avec les pays occidentaux dans certains domaines, par exemple dans le cadre du QUAD (avec les États-Unis, le Japon et l'Australie), mais aucune obligation d'alliance au sens d'une appartenance exclusive à un camp.
Les menaces de Trump ne sapent pas cette ligne de conduite, elles la confirment plutôt. En effet, intégrer l'Inde dans la logique de formation d'un bloc occidental reviendrait, pour New Delhi, à renoncer à ses propres intérêts face à la concurrence de la Chine, son principal rival géopolitique.
Dans le secteur de l'énergie en particulier, ce n'est pas une option. L'approvisionnement en énergie russe bon marché est crucial pour l'Inde, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan stratégique, notamment face à la concurrence de Pékin. Une rupture totale avec Moscou affaiblirait Delhi sur le plan géopolitique, au lieu de la renforcer.

Effet involontaire : le Groupe BRICS devient plus tangible
Cette constellation donne lieu à une évolution qui n'était sans doute pas prévue à Washington: la consolidation structurelle progressive des pays du BRICS sous la pression des mesures occidentales. Ce qui était longtemps considéré comme une alliance informelle d'États économiquement hétérogènes acquiert une nouvelle fonction face à la menace extérieure: celle d'un cadre protecteur contre une politique commerciale et des sanctions excessives.
Il convient toutefois de noter que ce n'est pas la Russie qui cherche la confrontation, mais les États-Unis qui provoquent des réactions par leur politique de pression unilatérale. L'Inde n'est pas rebelle, mais réaliste: elle s'oriente vers ses propres intérêts et non vers des exigences de loyauté géopolitique.
La multipolarité comme conséquence, pas comme objectif
Les développements actuels montrent que l'ordre mondial multipolaire n'est pas le résultat d'une formation ciblée de contre-pouvoirs, mais une réaction à la volonté de préservation des structures hégémoniques. Trump, comme beaucoup dans son administration, agit selon une conception du pouvoir qui trouve ses racines dans la logique bipolaire de la guerre froide : ceux qui ne se soumettent pas sont sanctionnés.
Mais les États du Sud ont appris à ne plus considérer ces mesures comme inévitables. Ils créent des alternatives, allant de nouveaux systèmes de paiement à des accords énergétiques régionaux. La réponse à la pression occidentale n'est pas la confrontation, mais la décentralisation.
Trump voulait discipliner l'Inde. Il a déclenché une nouvelle vague d'affirmation stratégique, non seulement à New Delhi, mais aussi à Moscou, Pékin, Brasilia et Pretoria. Les pays du groupe BRICS n'y gagnent pas sur le plan idéologique, mais sur le plan de la fonction qu'ils se donnent : celle d'un espace de souveraineté géopolitique face à un Occident qui se présente de plus en plus comme un ensemble bloqueur plutôt que comme un partenaire fiable ou rationnel.
Le fait que cette évolution soit non seulement involontaire, mais aussi irréversible, devrait devenir l'un des phénomènes géopolitiques les plus marquants des années à venir.
L'Inde reste stable, l'Allemagne sombre : dans son nouveau livre « Der hybride Krieg gegen Deutschland » (La guerre hybride contre l'Allemagne), l'auteur à succès Gerhard Wisnewski montre comment notre pays est pris en tenaille sur différents fronts. Commander via le lien supra.
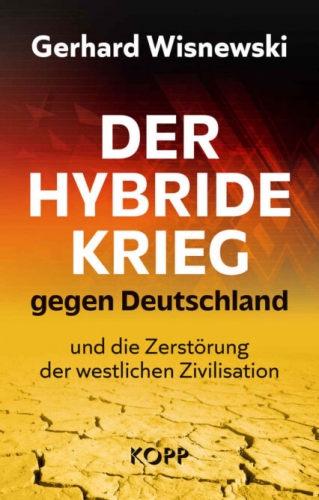
12:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politiquer internationale, inde, asie, affaires asiatiques, brics, sanctions, donald trump, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 août 2025
Les néoconservateurs entraînent Trump vers l'enfer

Les néoconservateurs entraînent Trump vers l'enfer
Alexandre Douguine
Tatiana Ladiaïeva : Commençons par évoquer un nouveau cycle de négociations. Il y a au moins quelques prémices. Je parle des négociations entre Moscou et Kiev. Selon certaines informations, notamment turques, une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu à Istanbul mercredi ou jeudi. Mais, pour être honnête, il n'y a pas encore de confirmation officielle. Zelensky aurait déclaré la veille qu'il était enfin prêt à rencontrer des interlocuteurs russes, alors que Moscou attendait depuis longtemps une réaction de sa part. J'aimerais beaucoup connaître vos prévisions, Alexandre Gelevitch.
Alexandre Douguine : J'ai déjà exprimé mon point de vue à plusieurs reprises; à l'heure actuelle, les négociations avec l'Ukraine n'ont qu'un seul sens: montrer à Trump la détermination de la Russie à œuvrer pour la paix. Trump, comme nous le voyons, se méfie de nous et ne croit pas vraiment à notre volonté pacifique. Il semble commencer à comprendre que seule la victoire nous satisfera. Les négociations ne peuvent donc porter que sur un seul sujet: la reconnaissance immédiate par l'Ukraine de sa défaite militaire. Mais dans les conditions actuelles, cela est absolument irréaliste.
Des questions secondaires pourraient être abordées, comme la restitution des corps de milliers ou de dizaines de milliers de soldats ukrainiens à leurs familles ou d'autres aspects humanitaires et techniques. C'est une bonne chose, mais cela doit pouvoir se faire sans une capitulation sans condition, l'Ukraine n'ayant rien à offrir, et nous ne sommes intéressés par rien d'autre. Nous envoyons ainsi un signal clair à Trump: nous sommes prêts à la paix, mais uniquement à une paix qui implique la capitulation sans condition de Kiev et la reconnaissance de sa défaite totale dans cette guerre. C'est notre condition pour la paix, et nous y tenons fermement. Elle a été transmise à plusieurs reprises à la partie américaine, directement ou indirectement, le plus souvent indirectement, mais parfois aussi directement.
Il n'y a donc actuellement aucune condition réelle pour des négociations. L'Ukraine change de position parce que le régime de Zelensky sent les hésitations de Trump. Cela ne signifie pas pour autant que Trump a abandonné l'Ukraine face à la Russie ou même face à l'Union européenne. Mais leur bluff devient évident. Lorsque Trump propose à l'Union européenne de payer les armes américaines destinées à l'Ukraine, c'est un discours absurde, comme beaucoup d'autres qu'il a prononcés ces derniers temps. Le budget de l'OTAN est principalement constitué de fonds américains, l'Europe n'y contribue que pour une petite part. Revendre des armes américaines à l'OTAN, c'est les revendre aux États-Unis eux-mêmes. Les Européens sont désorientés, ne comprenant pas ce qui se cache derrière tout cela. Ils ne sont pas capables de mener seuls la guerre contre nous en Ukraine, même en mobilisant le potentiel économique de l'Allemagne et le modeste potentiel de la France, cela ne suffirait pas. Dans ces conditions, Zelensky comprend que les choses vont mal, même s'il ne s'agit pas encore d'un refus total d'aide, mais seulement d'hésitations de la part de Trump.

Ces hésitations sont déjà une catastrophe pour l'Ukraine. Zelensky n'a pas pu atteindre ses objectifs dans la guerre contre nous, même avec le soutien total des États-Unis et de l'Union européenne, un crédit illimité, une quantité énorme d'armes, un soutien politique et financier. Il n'a rien obtenu.
Maintenant que la position de Trump commence à vaciller – il n'a pas encore refusé, mais il hésite déjà –, cela se répercute immédiatement sur l'ensemble du système politique et militaire ukrainien. C'est précisément pour cette raison que Zelensky se lance dans des négociations: il sent que la situation se détériore. Il est encore trop tôt pour parler d'une réduction ou d'un arrêt des livraisons d'armes américaines, mais ces hésitations suffisent à perturber le système ukrainien. C'est pourquoi, pour être honnête, ces négociations ne nous sont d'aucune utilité. Il est inutile de tenter de convaincre Trump, il suit son propre programme. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, il ne nous offrira pas la paix, c'est-à-dire la victoire de la Russie, mais il résistera.
Récemment, une écrasante majorité de républicains ont voté en faveur de la reprise de l'aide à l'Ukraine, tout comme l'ensemble des démocrates. Seuls 60 membres républicains du Congrès ont exprimé un point de vue différent, ce qui est beaucoup, mais pas assez pour bloquer l'aide. La situation reste défavorable pour nous. Nous devrons nous battre et aller vers la victoire par nous-mêmes, quoi qu'il en coûte. En ce sens, les initiatives de paix de Zelensky sont une provocation. Je resterais prudent: je sacrifierais encore un millier ou des dizaines de milliers de vies, je lui demanderais de se calmer, et pour le reste, je lui poserais un ultimatum exigeant une capitulation sans condition.
Il ne faut plus prêter attention aux actions de Trump. Il va hésiter, mais je pense qu'il ne veut pas d'une guerre nucléaire pour l'instant, ce n'est pas son style. S'il ne cherche pas à provoquer un conflit nucléaire de manière unilatérale, le reste n'a pas d'importance fondamentale. Nous sommes de toute façon en guerre contre l'Occident, qui apporte un soutien maximal à l'Ukraine. Tant que nous n'aurons pas renversé le cours de cette campagne militaire par une victoire, il n'y aura pas de paix.
Tatyana Ladiaïeva : Je voudrais préciser : avec quel message la délégation ukrainienne peut-elle se rendre à Istanbul (où que se déroulent désormais ces négociations et quel que soit le jour) ?
Alexandre Douguine : Je suis sûr qu'ils exigeront la restitution des quatre régions, de la Crimée et des réparations colossales s'élevant à plusieurs milliards ; en substance, la reconnaissance de la défaite de la Russie et la restitution de tous les territoires, rien d'autre.
Tatyana Ladiaïeva : Donc, rien ne change ?
Alexandre Douguine : Ils vont simplement appeler Trump, et Zelensky dira : « J'ai proposé des négociations, vous m'obligez à rencontrer les Russes, je suis prêt, mais ils refusent ». C'est bien sûr ce qui se passe. Pourquoi devrions-nous nous humilier ? Notre réponse est un ultimatum : hissez le drapeau blanc, sinon nous continuerons comme maintenant. Nous avons peu d'atouts, mais nous avons tenu bon. Nous ne nous sommes pas effondrés, nous résistons depuis quatre ans déjà, nous avançons lentement mais sûrement. Cette situation ne peut guère empirer pour nous, toutes les sanctions possibles ont déjà été prises.
Quant aux nouvelles sanctions que Trump menace d'imposer après la période de cinquante jours qu'il nous a annoncée, de son point de vue, nous devons pendant ce temps conquérir tout ce que nous pouvons en Ukraine et entamer des négociations tout en conservant ce que nous avons conquis. Mais il exigera la fin des hostilités. En 50 jours, nous ne prendrons pas Kiev, nous ne libérerons pas Odessa, Kharkiv, Zaporijia, Kherson, Dnipropetrovsk. Nous n'aurons pas assez de temps. Par conséquent, de nouvelles menaces de sanctions suivront.
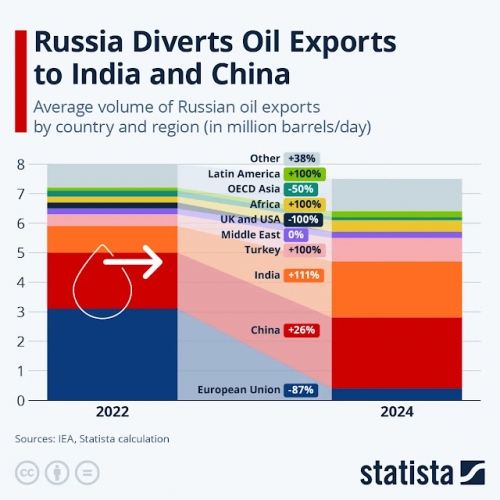
Contre qui ? Contre ceux qui achètent notre pétrole, l'Inde et la Chine. Tout le reste n'a pas d'importance, on peut s'en passer. L'Inde et la Chine seront confrontées à des sanctions, mais la Chine a déjà gagné la guerre des sanctions contre Trump: les tarifs douaniers menaçants ont été ramenés à un niveau acceptable pour eux. Une dispute avec l'Inde signifierait une rupture avec un allié clé des États-Unis en Asie. Les deux scénarios sont irréalistes. Les menaces semblent effrayantes, mais à y regarder de plus près, elles sont difficilement réalisables. Des sanctions de 100 ou 500% n'auront pas d'impact décisif sur nos volumes de pétrole, mais la menace elle-même pourrait transformer l'Inde et la Chine en ennemis des États-Unis. Dans ce cas, la Chine nous soutiendrait probablement encore plus activement, ce qui est déjà perceptible ces derniers jours.
Malgré ses fanfaronnades et sa brusquerie, Trump dispose de peu de moyens de pression réels sur nous. Nous, en revanche, jouissons d'une grande stabilité, qu'il convient de renforcer. Nous avançons inexorablement vers la victoire. Les négociations, en fin de compte, ne mènent à rien et ne peuvent aboutir tant que ce régime est au pouvoir en Ukraine, tant qu'ils n'ont pas perdu plusieurs grandes villes. À l'étape suivante, les négociations pourraient prendre tout leur sens : nous serions alors plus proches d'une capitulation sans condition probable. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Toutes les discussions se résumeront à ce que nous proposerons: «Reprenez vos morts», et ils répondront: «Nous n'en voulons pas» ou «Vous ne nous rendez pas les bons». Tout se terminera ainsi, tristement. Le geste de bonne volonté perd tout son sens, devenant rituel, comme un «bonjour» dit sans souhaiter la bonne santé. Ce n'est qu'une formalité.
Tatyana Ladiaïeva : C'est un jeu de mots. Un point très important: peu importe que ce soit cette semaine ou dans 50 jours, le conflit ukrainien reste non résolu, l'opération spéciale se poursuit. Nous ne dialoguons pas encore avec Kiev, et les Américains – je ne sais pas s'ils se sont retirés de cette question ou s'ils continuent à fournir une aide militaire, dont nous parlerons également tout à l'heure. Mais la question clé est la suivante: comment la prolongation du conflit ukrainien affectera-t-elle nos relations avec Washington ? Après tout, nous avons essayé d'établir ces relations.
Alexandre Douguine : Il devient évident qu'il est impossible d'améliorer les relations avec Washington. Le comportement de Trump au cours des derniers mois ou des derniers deux mois parle de lui-même. Il ne reste rien du programme initial du mouvement MAGA et du slogan « Make America Great Again » qui l'ont porté au pouvoir. Il est revenu à la politique néoconservatrice classique des républicains.
Hélas, l'établissement de relations avec les États-Unis n'était possible qu'à condition qu'ils renoncent à un monde unipolaire, au mondialisme, à l'hégémonie et à l'impérialisme. Cela avait été promis, ce n'était pas seulement notre espoir naïf. Trump avait fondé sa campagne électorale sur cela. Les électeurs américains l'ont soutenu parce qu'il avait promis de se concentrer sur les problèmes intérieurs, de lutter contre l'immigration, de dénoncer l'élite corrompue et vicieuse du Parti démocrate et de détruire l'État profond. Au lieu de cela, nous assistons à un soutien inconditionnel au génocide des Palestiniens à Gaza, à une attaque contre l'Iran, à un soutien à Netanyahou, à une nouvelle aide financière à l'Ukraine, à des menaces contre la Russie et à la négation de l'affaire Epstein.
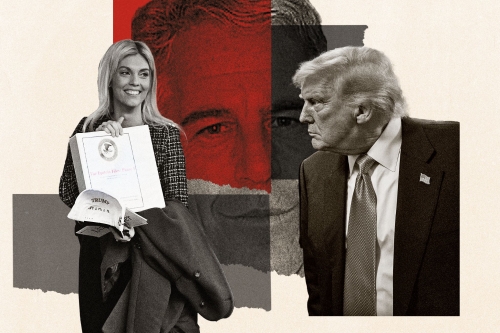
Aujourd'hui, Trump affirme que cette fameuse affaire n'existe pas, alors que c'est précisément grâce à la promesse de publier le dossier Epstein, qui détaillait les orgies pédophiles de l'élite américaine et occidentale, qu'il a remporté la victoire. Trump s'est tellement écarté de son programme, qui nous ouvrait une fenêtre pour un rapprochement et une désescalade, qu'il est désormais un politicien néoconservateur agressif et impulsif comme les autres. Chaque jour, il fait des signes d'attention et d'amitié au terroriste Lindsey Graham, tout en critiquant ses propres partisans, grâce auxquels il est arrivé au pouvoir. Trump a renié sa base électorale et l'idéologie sous laquelle il a remporté la victoire. Dans ces conditions, un rapprochement avec les États-Unis devient douteux: cela revient à tenter de négocier avec un ennemi cynique et sournois qui ne respecte pas les règles, revient sur ses décisions et prétend qu'elles n'ont jamais existé.
Cela ressemble à de la démence, mais pas à la démence silencieuse de Biden, qui était contrôlé par les mondialistes, mais à la démence violente de l'establishment néoconservateur américain. Cela exclut toute possibilité rationnelle de rétablissement pacifique des relations. Peut-être que les tergiversations de Trump s'avéreront plus favorables pour nous s'il est distrait par un autre événement ou un autre segment de la politique internationale. Mais il ne faut plus s'attendre à des stratégies rationnelles et positives dans nos relations avec lui. S'il a trahi ses partisans de cette manière, que fera-t-il de nous ? Il a tourné le dos à ceux qui ont voté pour lui, sa base électorale, indispensable pour les élections de mi-mandat au Congrès et au Sénat l'année prochaine. Il la méprise, la considérant comme insignifiante. Comment peut-on négocier avec de tels personnages sur des questions fondamentales telles que la guerre et la paix, la coopération économique ?
Nous devons nous concentrer davantage sur nous-mêmes et renforcer nos liens avec la Chine, établir des relations avec les autres pôles d'un monde potentiellement multipolaire: l'Inde, le Brésil, le monde islamique, l'Amérique latine, l'Afrique, parties du monde où une politique indépendante et souveraine est encore possible. C'est ce que nous avons fait, et Trump représentait une fenêtre d'opportunité lorsque, selon ses propres termes, l'Amérique était prête à reconnaître la multipolarité et à s'y intégrer tout en conservant sa position de leader.
Mais aujourd'hui, Trump déclare que le BRICS est son ennemi principal, changeant complètement son discours. Dans cette situation, nous n'avons d'autre choix que de compter sur nous-mêmes et sur nos alliés dans le cadre de la multipolarité. Il faut avant tout approfondir nos relations avec ceux qui nous soutiennent: la Corée du Nord, aider l'Iran à se reconstruire. Le plus important, c'est notre partenariat stratégique avec la Chine. C'est sérieux. Le rapprochement entre la Russie et la Chine forme un bloc puissant, capable de relever les défis dans la région du Pacifique, en Ukraine et en Europe de l'Est.

Tatyana Ladiaïeva : Je rappellerai l'une des dernières déclarations du président chinois Xi Jinping : si Trump continue à faire pression, y compris en imposant des sanctions contre les partenaires qui coopèrent avec la Russie, nous nous rapprocherons encore plus de Moscou, renforcerons notre amitié et conclurons des accords sans céder à Trump.
J'ai des questions sur le terroriste Lindsey Graham : quelle pression exerce-t-il actuellement sur Trump ? Je remarque une tendance : il annonce de plus en plus souvent des décisions au nom de Trump. Vous avez également mentionné leur rapprochement. Je ne comprends pas très bien comment Lindsey Graham et, par exemple, le chancelier allemand Friedrich Merz – qui, selon des informations provenant de Berlin, serait sous son influence – ont pu influencer la décision de Trump de continuer à soutenir l'Ukraine. Trump semblait être un leader fort et volontaire. De quels leviers de pression disposent-ils ? Cette question reste d'actualité.
Alexandre Douguine : Il faut noter que Lindsey Graham, déclaré terroriste en Russie, est un représentant des néoconservateurs, un groupe influent au sein de l'establishment américain. Ils sont de droite, contrairement aux mondialistes de gauche – Biden, Obama, Hillary Clinton –, mais, en substance, ils sont également en faveur de l'hégémonie. Leur programme est proche de celui des mondialistes de gauche, mais met l'accent sur l'impérialisme américain plutôt que sur la démocratie universelle. Ils sont de fervents partisans d'Israël, considérant ses intérêts comme prioritaires par rapport à ceux des États-Unis. Pour les mondialistes de gauche, les valeurs libérales européennes ou universelles sont plus importantes qu'Israël ou même l'Amérique.
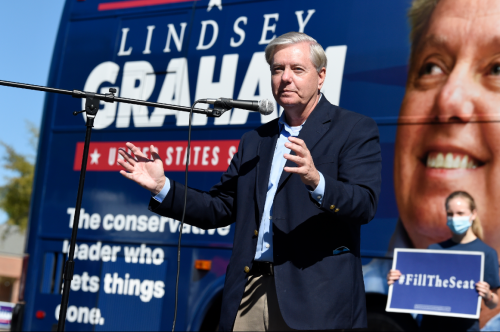
Ni les uns ni les autres ne sont de véritables patriotes américains. Cependant, les néoconservateurs sont convaincus que l'impérialisme, le néocolonialisme, le soutien à Israël et la lutte contre toute entité souveraine constituent l'objectif principal de la politique américaine. Au final, leur stratégie diffère peu de celle des mondialistes.
Les néoconservateurs ont été les principaux adversaires de Trump. Lors de son premier mandat, entre 2016 et 2020, il a conclu un pacte avec eux, mais ils l'ont tous trahi, sans exception, Bolton, Pompeo. Lindsey Graham faisait partie du groupe « Never Trump » (« jamais Trump » : n'importe qui, sauf lui). Néanmoins, ils représentent ouvertement l'État profond, l'ennemi principal du mouvement MAGA.
Pour les partisans de Make America Great Again, Graham est l'incarnation du mal absolu: l'État profond, le colonialisme, les interventions, le financement sans fin d'Israël, de l'Ukraine et le harcèlement de tous les adversaires de l'hégémonie américaine, la lutte contre les BRICS et le multipolarisme. En même temps, Graham est un lobbyiste du complexe militaro-industriel, une figure clé de l'État profond. C'est précisément lui que Trump a promis de détruire, d'assécher le marais, d'éradiquer l'État profond — c'est pour cela qu'il a été élu. Son rapprochement avec Graham, qui déclare ouvertement: « J'ai conseillé cela à Trump, et il le fera », est perçue comme une anomalie flagrante non seulement par nous, observateurs extérieurs, mais aussi par les Américains.
Trump s'est positionné comme un homme politique imprévisible : « Je fais ce que je veux, je suis souverain, je ne dépends de personne, je peux prendre des décisions impopulaires, j'ai toujours raison ». C'est ainsi qu'on le connaissait, et on l'a cru quand il a promu l'idéologie MAGA. Mais maintenant, il n'écoute plus ni MAGA, ni même lui-même. Ses paroles et ses promesses, prononcées il y a 15 minutes ou 15 jours, n'ont aucune autorité pour lui. Sous l'influence de l'État profond, il s'est enfoncé plus profondément que lors de son premier mandat.
Graham est le symbole de la soumission totale de Trump à l'État profond. Quand ils apparaissent ensemble, par exemple sur un terrain de golf, les réseaux sociaux explosent d'indignation: des dizaines, des centaines de milliers de messages de partisans de MAGA crient: « On nous a trahis! L'État a été détourné, Trump est pris en otage!». S'il s'éloigne un instant de Graham, l'espoir renaît: «Peut-être qu'il reviendra, ce n'est que temporaire». Certains élaborent des théories conspirationnistes selon lesquelles Trump se rapproche délibérément de Graham afin de gagner sa confiance et de détruire l'État profond de l'intérieur. Mais c'est là du désespoir.
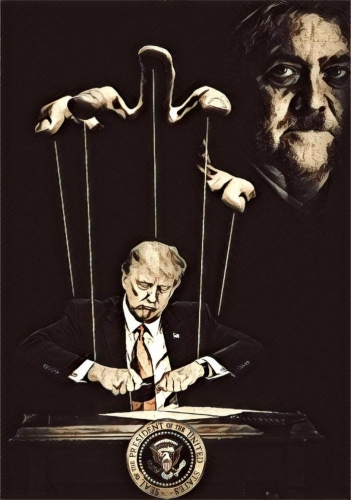
En réalité, Trump est une marionnette entre les mains de l'État profond, qu'il prétendait détruire pour arriver au pouvoir. C'est une surprise non seulement pour nous, mais aussi pour les Américains. Nous avons fait confiance à ce personnage excentrique, égocentrique, mais souverain qu'est Trump. Avec la valise nucléaire, c'est difficile, mais on pouvait s'y adapter. Mais lorsqu'il n'est pas indépendant et qu'il suit une logique imposée, cela nous oblige à baisser les bras. Il n'est pas seulement bruyant et excentrique, il est aussi dépendant. Cette combinaison – la dépendance envers ceux qu'il qualifiait d'ennemis et qui sont les ennemis de la société américaine – est grave.
Graham est une personnalité importante. On pensait qu'il disparaîtrait de la scène politique, mais son influence n'a fait que croître. Malgré son ton hystérique et incendiaire, ses propos doivent être pris au sérieux. Il est celui qui veille sur Trump depuis les profondeurs de l'État, pour employer des termes mafieux. C'est exactement ainsi que cela se présente et que les Américains le perçoivent.
Tatyana Ladiaïeva : Le président américain Donald Trump a-t-il vraiment pu prendre la décision de continuer à soutenir l'Ukraine sous l'influence du chancelier Merz ? Qu'adviendra-t-il de ce soutien ? Comment l'Europe va-t-elle s'impliquer ? Les États-Unis, si je comprends bien, font semblant de ne pas s'impliquer directement, mais leurs plans commencent déjà à fonctionner via l'Europe.
Alexandre Douguine : Je ne pense pas que Merz soit capable d'influencer Trump de manière significative. Merz est également un néoconservateur, mais européen. L'Allemagne n'est pas un État souverain, mais un territoire occupé avec une autonomie quasi nulle. Sa politique est subordonnée à l'État mondial globaliste. L'influence de Merz ne tient pas à son statut de chancelier allemand, mais au fait qu'il fait partie du cabinet fantôme mondial qui contrôle Trump, tout comme l'État profond aux États-Unis.
Lindsey Graham est une incarnation plus frappante de cet État profond, tandis que Merz n'est qu'un exécutant. Il a été porté au pouvoir non sans manipulations, malgré d'autres tendances, notamment perceptibles en Allemagne de l'Est. Il a promis de lutter contre les migrants, mais dès son arrivée au pouvoir, il est revenu sur ses promesses. Merz est un technicien et son influence sur Trump est minime. Lindsay Graham, à titre individuel, n'a probablement pas non plus une influence significative. Il s'agit du fait qu'il représente la plus haute instance de gestion du monde. Merz fait partie de ce système.

Tout s'est passé comme prévu : les mondialistes et les néoconservateurs sont une seule et même instance mondiale qui dirige l'Europe occidentale, l'Union européenne et les États-Unis. Ce sont les mêmes personnes et les mêmes structures. Trump a été une intrusion inattendue avec des idéologies différentes, mais cela n'a pas duré longtemps, moins d'un an. Il a commencé par promouvoir à des postes clés des personnes telles que Tulsi Gabbard et J. D. Vance, qui n'étaient pas liées aux républicains traditionnels ou aux néoconservateurs. C'était eux le potentiel de MAGA. Mais la résistance de l'ancien establishment s'est avérée plus forte. Pourquoi aurait-il besoin d'une équipe qui n'est pas contrôlée par l'État profond ?
Les débuts étaient prometteurs, mais il y a un mois et demi, le système MAGA, l'indépendance et la politique autonome de Trump se sont effondrés. Les observateurs américains attribuent cela à l'influence israélienne. C'est peut-être exagéré, mais ils cherchent un facteur extérieur, voyant Trump et l'Amérique se faire détourner. Beaucoup d'Américains pensent que les services secrets israéliens sont derrière tout cela, forçant l'Amérique à servir des intérêts étrangers. On dit que la CIA et le Mossad contrôlent l'Amérique depuis longtemps. C'est peut-être exagéré, mais il y a une part de vérité dans cela.
Les Américains cherchent des responsables: qui a détourné Trump, qu'est-ce que l'État profond ? Graham et, dans une moindre mesure, Merz en sont les représentants. Merz n'est qu'un simple fonctionnaire de l'État mondial. Si l'État profond international décide de se préparer à la guerre contre la Russie, en laissant l'Amérique légèrement à l'écart et en faisant porter le poids principal à l'Union européenne, avec un soutien moins évident des États-Unis, c'est une décision grave. Elle ne dépend pas de Merz, Macron, Starmer ou Graham. On peut s'indigner autant qu'on veut contre ces dirigeants odieux, mais ce ne sont que des employés, une façade.
Nous sommes confrontés à un État international profond qui déclare la guerre à la Russie pour la détruire et qui cherche à nous infliger une défaite stratégique. Il ne correspond ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à leurs pays, ni à leurs intérêts nationaux. — C'est une force différente. Nous devons comprendre quelle est cette force. Même à haut niveau, nous n'en avons qu'une vision fragmentaire.
Auparavant, nous expliquions tout par l'idéologie communiste, le capitalisme, la lutte pour les marchés, les ressources, l'opposition au système socialiste. À l'époque, tout concordait. Mais au cours des dernières décennies de l'Union soviétique, nous avons perdu la compréhension de ce qui se passait en Occident. Nous avons besoin de nouveaux modèles. Pourquoi nous haïssent-ils ? Pourquoi veulent-ils nous détruire ? Quels sont les mécanismes, qui prend les décisions, à quel niveau ? S'ils sont capables de reformater le président américain, qui est arrivé avec le slogan de la destruction de l'État profond, en le transformant en quelque chose d'autre, sans l'emprisonner ni le tuer, comment est-ce possible ? Qui compose ce cabinet fantôme du gouvernement mondial ?

Les Américains, se sentant trahis, tentent de comprendre. Nous devons suivre leurs débats et réflexions de près, ils trouveront peut-être des indices. Mais c'est dangereux car cela peut coûter la vie à ceux qui fouinent trop là où il ne faudrait pas...
Nous, les Russes, ne comprenons pas tout à fait à quoi nous avons affaire. Nos pères spirituels ont leur propre vision, mais pour l'accepter, il faut partager leur vision du monde, que la société laïque n'est pas prête à prendre au sérieux. Il est extrêmement difficile de se faire une idée rationnelle du fonctionnement de cet État international profond qui se considère comme le gouvernement mondial. Parfois, cela est déclaré ouvertement, parfois cela reste dans une zone grise. Il faut y prêter une attention particulière. En Russie, nos centres intellectuels tentent de comprendre ce phénomène, mais leurs efforts sont encore préliminaires. C'est une bonne chose, mais il faut faire beaucoup plus.
Tatyana Ladiaïeva : Parlons d'Epstein pendant le temps qui nous reste. Je crois comprendre que l'affaire Epstein continue de diviser la société américaine en deux. Pouvez-vous nous dire s'il y a aujourd'hui plus de gens qui exigent du président américain, des fonctionnaires et des procureurs qu'ils révèlent tous les détails de cette affaire ?
Alexandre Douguine : L'affaire Epstein est liée au fait que le milliardaire Jeffrey Epstein, propriétaire d'un fonds spéculatif de plusieurs milliards de dollars, a été condamné pour avoir organisé un réseau pédophile auquel participaient régulièrement des représentants de l'élite américaine, dont Bill Clinton, Obama et de nombreuses autres personnalités, notamment issues des milieux européens et intellectuels.
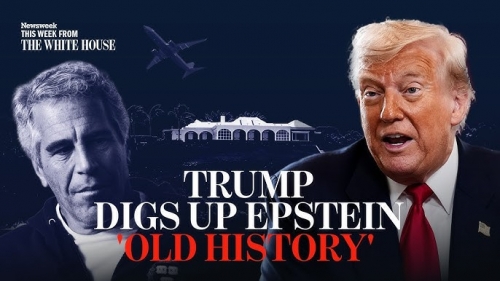
Les dossiers d'Epstein contiennent des informations compromettantes sur toute l'élite américaine. Trump avait promis de les publier après son arrivée au pouvoir. Epstein se serait suicidé dans sa cellule, mais il s'est avéré que plusieurs minutes d'enregistrement des caméras de surveillance avaient disparu: on le voit assis, puis pendu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Il y avait suffisamment de preuves dans le dossier pénal pour le condamner à plusieurs reprises. Sa plus proche collaboratrice, Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison. Elle est la fille d'un haut responsable des services secrets israéliens, et ce n'est là qu'une des nombreuses allusions dangereuses pour l'establishment.
Trump avait annoncé: «Je publierai les dossiers, nous détruirons le lobby pédophile». Mais il y a un mois, il a déclaré: «Il n'y a pas de dossier, ce sont des inventions des démocrates, parlons plutôt du temps qu'il fait au Texas». Il menace ceux qui posent des questions sur les dossiers: «Ce sont mes ennemis, je les écraserai». La société américaine est sous le choc: «Nous attendions ces dossiers, nous vous avons élu pour cela, et vous niez leur existence!».
Des informations circulent selon lesquelles Trump était proche d'Epstein et qu'il existe des informations compromettantes à son sujet. Elon Musk, qui s'est séparé de Trump, affirme que Trump figure dans ces dossiers et que c'est pour cette raison qu'il ne les publiera pas. On a l'impression que Trump est victime de chantage, peut-être de la part des services secrets, de l'État profond ou même des services de renseignement israéliens, qui le forcent à agir contrairement à ses promesses, à sa politique et à ses intérêts. Personne ne l'affirme catégoriquement, mais c'est un autre levier de contrôle sur Trump. Son changement radical de position sur l'affaire Epstein au cours du dernier mois a provoqué un véritable choc. Tout le monde attendait la publication, et il déclare qu'il n'y a rien. Alors pourquoi Maxwell purge-t-elle une peine de 20 ans? Pourquoi Epstein est-il mort? Pourquoi les procureurs ont-ils rendu leurs décisions précédentes? Il ne s'agit plus d'un simple événement politique, mais d'un crime pénal colossal, et Trump en devient complice.
Imaginez la situation dans laquelle il se trouve. Dans une telle situation, il peut décider de prendre des mesures extrêmes. Il est pris en otage par certaines forces, et c'est très grave.
16:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, alexandre douguine, donald trump, néoconservateurs |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 juillet 2025
Choc sur l’accord douanier: les Européens doivent payer pour la production d’armes aux États-Unis

Choc sur l’accord douanier: les Européens doivent payer pour la production d’armes aux États-Unis
Source: https://unzensuriert.de/305214-schock-ueber-zoll-deal-eur...
Des eurocrates comme Ursula von der Leyen ou le chancelier allemand de la CDU Friedrich Merz ont exprimé leur mépris à l’égard de Donald Trump avant les élections présidentielles américaines. Ce n’était pas là la bonne manière de préparer le contexte optimal pour négocier les tarifs lors de la rencontre qui vient de se dérouler en Écosse.
L’UE paie la facture, Trump en profite
La majorité des gens considère, de manière peu surprenante, que le résultat de ces négociations n’est pas bon. Environ 61% selon un sondage Oe24 (en date du 28 juillet, 8h30), pensent que l’UE paie après les négociations et que Trump en profite. Des observateurs ont eu l’impression que la cheffesse de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’était agenouillée devant le président américain et qu’elle s’était fait bien rouler lors des négociations.
« Ce sera la plus formidable de toutes les affaires », a déclaré Trump après l’accord, « nous l’avons eu (l'accord), c’est bien », a déclaré von der Leyen.
Encore 50 % de droits de douane sur l’acier et l’aluminium
La vraie question est de savoir ce que l’accord douanier de Turnberry en Écosse va nous apporter. L’accord sur le tarif de 15%, par exemple, pour les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs pourrait, selon les critiques, tuer d'innombrables sociétés en Europe. Surtout que l’acier et l’aluminium ne font pas partie de l’accord et restent soumis à une taxe douanière de 50%.
L’UE s'est donné l'obligation d'acheter de l’énergie aux États-Unis pour 750 milliards de dollars
Que l’UE – dans le cadre de l’accord – doive acheter de l’énergie aux États-Unis pour 750 milliards de dollars, alors qu’elle pourrait l’obtenir bien moins cher ailleurs, aura probablement aussi des conséquences gravissimes et rendra l’Europe encore plus dépendante des États-Unis. Cette dérive est également due à la politique des sanctions contre la Russie.
De plus, il a été convenu que l’UE doit investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, y compris dans la production d'armements que l’on souhaite produire "en commun".
Nos concitoyens devront payer la facture
Une chose est déjà sûre : la facture de tous ces accords sera présentée aux citoyens européens, qu’ils veuillent ou non investir dans des armes.
L’homme d’affaires Donald Trump a misé gros dans le différend douanier avec l’UE, menaçant d’imposer une surtaxe de 30%. Le fait qu’au final ce soit 15% et que l’Europe ait été contrainte d’investir aux États-Unis peut être considéré comme une belle réussite pour lui. Est-ce que la "Euro-Uschi" (= U. von der Leyen) pourra faire pareil, se réjouir avec autant de satisfaction?
19:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tarifs douaniers, donald trump, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 juillet 2025
L'empire de Trump et l'Europe

L'empire de Trump et l'Europe
Marco Rossi
Source: https://electomagazine.it/limpero-di-trump-e-leuropa/
Au final, l'Occident s'est donc regroupé de manière ordonnée sous la direction de Trump, mais bien sûr dans le strict cadre des objectifs fixés par les Seigneurs de Davos, qui sont les véritables maîtres et dirigeants de l'Occident.
L'objectif principal de ces seigneurs serait de reconquérir le monde entier et de le ramener sous leurs règles, qui sont celles du turbo-capitalisme et de la finance spéculative, tous deux entre des mains privées, qui sont en fait leurs mains...
Mais cet objectif est désormais un rêve inaccessible depuis au moins quinze ans; la Chine, la Russie, l'Inde et progressivement les pays du BRICS s'éloignent de plus en plus de l'emprise qu'exercent les structures de pouvoir occidentales (ONU, OTAN, Banque mondiale, Fonds monétaire, etc.) et construisent leurs propres structures qui s'opposeront inévitablement, à terme et de plus en plus nettement, à celles de l'Occident. En effet, nous sommes désormais dans un multipolarisme effectif et opérationnel, et ceux qui restent fidèles aux « fétiches anciens » se révèlent aveugles, ou sont simplement au service de la propagande occidentale.
Mais alors, que poursuivent réellement Trump et les seigneurs de Davos ?
Tout d'abord, l'hypothèse d'une guerre thermonucléaire directe entre les deux adversaires est à exclure, pour des raisons évidentes: même ceux qui s'opposent à l'Occident disposent d'armes nucléaires et de technologies hybrides de toutes sortes, de sorte que les seigneurs de Davos n'ont pas la moindre intention de voir leurs luxueuses résidences en Europe et aux États-Unis frappées par des ogives nucléaires.
Que les Occidentaux anxieux se rassurent donc, il n'y aura pas d'Armageddon apocalyptique final, mais il y aura bien d'autres conséquences graves et difficilement évitables.
En effet, la ligne à suivre est compréhensible à tous égards: l'Occident décadent et empêtré dans ses contradictions internes doit essayer de conserver le contrôle des parties de l'Empire qu'il peut encore dominer efficacement.
Si la Russie, la Chine et les BRICS sont désormais hors d'atteinte, il faut alors créer le maximum de difficultés – économiques, financières, militaires – aux ennemis et lutter par tous les moyens pour ne pas perdre l'Afrique, l'Amérique du Sud, ce qui reste de l'Asie, bref, lutter pour que le Limes soit le plus loin possible du fameux « milliard d'or » (à savoir les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, l'Australie et le Japon).

Mais un problème incontournable est que les États-Unis sont en pleine crise économique et financière interne, et alors ?
Il faut donc faire payer une bonne partie de la gestion colossale de l'Empire aux colonies les plus riches, c'est-à-dire à l'Europe: d'où les droits de douane de 30% pour les Européens, puis l'obligation de porter les dépenses militaires, qui s'élèvent généralement autour de 2% du PIB, à 5%, mais cela ne suffit pas car même la guerre en Ukraine – qui ne peut être interrompue pour ne pas laisser la Russie gagner – doit être financée par les Européens, de sorte que les États-Unis construiront gentiment toutes les armes nécessaires, mais ce sont les Européens qui les paieront.
Mais il y a un autre problème incontournable: en Occident, c'est la loi des Seigneurs de Davos qui domine, où le turbo-capitalisme et la finance spéculative, qui sont entre les mains du secteur privé, dictent leur loi à l'économie, mais ce mécanisme génère nécessairement des divisions de plus en plus profondes dans la société occidentale, conduisant à la disparition de la classe moyenne. En d'autres termes: le système occidental draine structurellement les ressources de la classe moyenne et des classes populaires pour les transférer aux plus riches, au fameux 1% le plus riche, ce qui fait que 99% de la population occidentale s'appauvrit chaque année davantage.
Les BRICS, cependant, ne suivent pas du tout ce système et accompagnent l'initiative privée dans l'économie d'une forte présence de l'État dans l'économie, comme c'était le cas autrefois – avant 1989 – en Europe et en Italie, tout en contrôlant également la finance spéculative et les banques, comme c'était encore le cas en Occident avant 1989.
La comparaison avec les BRICS sera donc de plus en plus difficile, car le système dit mixte en économie – à savoir la synergie entre le public et le privé, avec l'État qui contrôle les banques et la souveraineté monétaire – est incomparablement plus efficace et plus souple que le turbo-capitalisme occidental, où les grandes multinationales et les grandes banques d'investissement privées contrôlent tous les secteurs de l'économie et de la finance.
En d'autres termes: le système privé mondial occidental est conçu pour fonctionner comme un totalitarisme de la finance spéculative, et si le monde entier est subordonné à un tel système, alors le système fonctionne; or, bien sûr, les différences s'accentuent et les ressources vont organiquement et progressivement dans les mains du 1%, celui des plus riches, tandis que les 99% restants deviennent de plus en plus pauvres et contraints à la subordination...
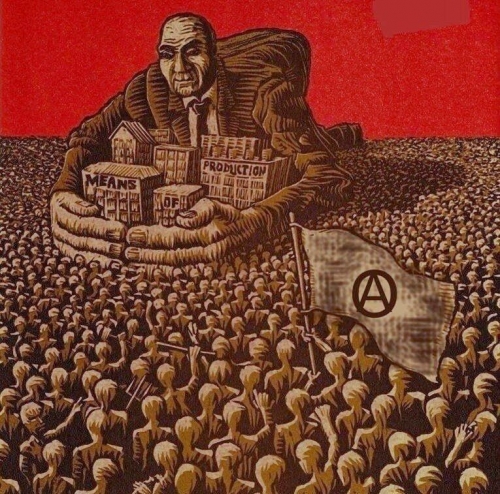
On peut dire que de 1991 à la crise de 2008, le monde a subi ce joug, a dû se plier aux règles des Seigneurs de Davos et de la finance spéculative, mais progressivement, avec l'émergence des contradictions et la naissance des BRICS, qui étaient systématiquement ridiculisés au début, les choses ont radicalement changé.
À l'heure actuelle, le système occidental ne peut être imposé qu'à environ 50% de la population mondiale, voire moins, si l'on tient compte de la démographie. Par conséquent, les escroqueries financières spéculatives ou les jeux truqués du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale n'ont que peu d'impact sur plus de la moitié de la population mondiale...
Pour comprendre en détail: les ressources du monde en dehors de l'Occident doivent désormais être payées aux prix fixés par les ennemis de l'Occident et non par notre propre spéculation financière, et nous ne pouvons pas les obliger à nous les vendre au prix qui nous convient. Il en sera bientôt de même pour le destin du dollar, car nous ne pouvons pas obliger nos ennemis à commercer avec notre monnaie...
Des temps difficiles s'annoncent donc: pas de guerre nucléaire, certes, mais un appauvrissement radical de l'Europe, qui devra payer pour régler les contradictions internes des États-Unis, et, en plus devra renoncer à l'énergie russe à bas prix et aux marchés des BRICS; nous devrons également payer la guerre en Ukraine, le réarmement de nos armées – avec des armes américaines, pour améliorer le rendement de l'industrie américaine – et, pour couronner le tout, nous devrons également accepter de nouveaux droits de douane qui garantiront les ressources au centre de l'Empire, qui sera toutefois toujours en difficulté car les autres – à savoir les BRICS – sont désormais armés de l'arme nucléaire et donc libérés de l'emprise de notre néocolonialisme – pardon ! – de l'emprise des Seigneurs de Davos.
21:23 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, états-unis, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 juillet 2025
La pause de Trump avant l’Armageddon

La pause de Trump avant l’Armageddon
Retarder un affrontement avec la Russie et lâcher le mouvement MAGA
Alexander Douguine
Alexander Douguine révèle ici que Trump est une figure vacillante qui, pris entre une guerre avec la Russie et la colère de son mouvement MAGA, privilégie le délai au destin, reportant l’apocalypse de cinquante jours.
Hier, beaucoup s’attendaient à ce que Donald Trump fasse des déclarations nettes, concrètes et menaçantes concernant la Russie. Cependant, il a choisi de repousser une confrontation sérieuse — une confrontation que les néoconservateurs insistaient activement pour qu'il l'enclenche. La situation équivalait, très probablement, à un pari 50/50.
Trump aurait pu annoncer des sanctions sévères ou des livraisons sans précédent d’armes à l’Ukraine et ce, en grande quantité. D’un côté, cela aurait pu détourner l’attention des Américains de sa décision de ne pas publier la liste des clients d’Epstein — une décision qui a transformé bon nombre de ses anciens soutiens en opposants.

Sur tout le territoire des Etats-Unis, les militants du mouvement MAGA brûlent, par dépit, leurs casquettes sur la voie publique.
Tout le mouvement MAGA est actuellement contre Trump parce qu’il a, à plusieurs reprises, trahi leurs attentes de manière flagrante et cynique. D’abord, il s’est lancé dans la guerre contre l’Iran. Maintenant, il refuse de divulguer les dossiers sur le lobby pédophile d’Epstein aux États-Unis — ce qui était initialement un point clé de sa plateforme électorale. En conséquence, une cascade de supporters l’a abandonné. En substance, tout le mouvement MAGA, tout le trognon du trumpisme, se dresse maintenant contre Trump.
Dans ce contexte, on aurait pu s’attendre à ce que Trump tente de détourner l’attention avec une Troisième Guerre mondiale — un « Armageddon » contre la Russie — en annonçant des mesures effrayantes et extrêmes: de véritables sanctions capables de frapper aussi la Chine et l’Inde, principaux consommateurs des ressources énergétiques russes, et des livraisons de missiles de portée moyenne à Kiev, ce qui marquerait effectivement le début d’un Armageddon ouvert.
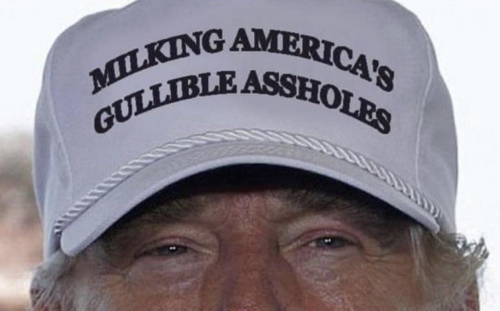
Trump aurait pu faire cela pour détourner l’attention de ses échecs — ou choisir de ne pas le faire, sachant que MAGA lui serait alors encore plus hostile. Un des principes fondamentaux du mouvement, et celui qui a permis à Trump d’accéder au pouvoir, était de mettre fin au conflit en Ukraine et d’arrêter de soutenir Kiev. Fondamentalement, il avait deux options: calmer le jeu (la "désescalade"), chercher la détente et tenter de regagner de l’influence sur le mouvement MAGA — ou lâcher ce public, abandonner le mouvement MAGA complètement et déclencher un conflit direct avec la Russie, créant ainsi un état d’urgence. Il aurait pu choisir l’une ou l’autre voie, mais finalement, il n’en a choisi aucune, reportant tout à une prochaine étape.
Il a lancé des menaces envers la Russie tout en reconnaissant en même temps la grande compétence ès-négociations du président russe Vladimir Poutine, montrant que Poutine est un homme dur qui ne compromet pas ses intérêts nationaux. En revanche, Trump, lui, compromet ses propres intérêts. Toute comparaison entre les deux est donc clairement à l’avantage de Poutine. La Russie a un dirigeant fort, ferme, poli, qui axe sa politique sur des principes, qui ne trahit pas son électorat — contrairement au leader américain. Dans cette compétition réelle et concrète, Trump perd sans aucun doute. Il a perdu le soutien de ses électeurs et est sur une trajectoire descendante. Son charisme et ses plans s’effondrent. En réalité, comme disent les jeunes, c’est un « échec épique » — un échec complet en politique intérieure.
Cependant, il n’a pas choisi de détourner l’attention mondiale de cet échec par une escalade avec la Russie. Il n’a pas dit grand-chose; il a simplement menacé qu'une telle escalade pourrait encore arriver, mais pas maintenant, peut-être dans cinquante jours. Mais même après cinquante jours, il pourrait changer d’avis — ou le faire demain. Trump se comporte de manière très imprévisible, et, à cet égard, on pourrait dire, frivole.
Pourtant, la pire issue — une déclaration immédiate de la Troisième Guerre mondiale — n’a pas eu lieu. Cela ne veut pas dire qu’elle ne se produira pas plus tard: dans cinquante jours, dans dix jours ou dans trois. En tout cas, l’élan d’attente entourant ce lundi a été efficacement désamorcé par le retour de Trump à une position neutre. La dynamique d’escalade reste énorme. Le monde file à toute vitesse vers l’Armageddon. Mais, pour l’instant — du moins — cela ne commencera pas aujourd’hui.
En conséquence, la bourse russe a connu une légère hausse, bien qu’en réalité elle ne devrait pas dépendre de telles choses, surtout compte tenu des pourcentages négligeables qui sont impliqués. Notre marché boursier est fondamentalement défectueux, car il est surveillé par Nabiullina, qui voit la bourse comme une rivale de la Banque centrale — comme c’est habituel dans tout pays et sous tout système. En résumé, notre système est simplement mal conçu, donc ce n’est pas un indicateur pertinent. Je ne lui accorderais pas trop d’attention.
Ce qui est positif, toutefois, c’est que la guerre n’a pas commencé hier. Cela signifie que son début a été quelque peu retardé. Bien que rien ne soit certain, tout peut arriver. L’histoire reste ouverte. Trump a pris une pause, prolongeant ses stratégies inefficaces, envers nous et envers l’Ukraine, de cinquante jours supplémentaires. Il a promis de livrer des systèmes Patriot à l’Ukraine, qui seront payés par les Européens, bien que cette décision ait déjà été prise il y a quelques temps. En somme, Trump a tenté de faire sensation à partir de quelque chose qui ne sera pas sensationnel. En d’autres termes, il a déclaré, en substance :
« Maintenant, je proclame haut et fort que je ne proclame rien. »
Tout reste dès lors comme avant. Mais cette fois, l’intervalle qui nous a été donné — avant la reprise du conflit mondial aujourd'hui reporté — doit être utilisé pour renforcer notre pays, la Russie. Nous ne pouvons plus compter sur personne, ni placer nos espoirs ailleurs. Seulement sur nous-mêmes. Ce que nous construisons de nos propres mains, c’est ce que nous aurons. Par conséquent, nous devons armer, réarmer, surarmer, renforcer, consolider notre souveraineté, et orienter la société vers des trajectoires militaires à long terme. C’est ce qui doit être fait — quoi qu’il arrive. L’Armageddon ne commencera pas aujourd’hui. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne commencera pas demain.
17:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : russie, alexandre douguine, états-unis, donald trump, actualité, politique internationale, maga |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 juillet 2025
Trump a été retourné et le mouvement MAGA est orphelin...

Trump a été retourné et le mouvement MAGA est orphelin...
Musk peut-il raviver la rébellion et défier l’Uniparty?
Alexander Douguine
Alexander Douguine affirme que Trump a été détourné par l’Uniparty mondialiste, laissant le mouvement MAGA trahi mûr pour une renaissance via le nouveau Parti América d’Elon Musk, en tant que véritable opposition américaine.
L’idée qu’Elon Musk crée un nouveau parti appelé « America » n’est en aucun cas vouée à l’échec. Tout ce à quoi Musk se consacre, il le réalise. À bien des égards, c’est lui qui a contribué à faire monter Trump au pouvoir avec des slogans radicalement opposés à l’establishment. Musk s’est investi corps et âme dans le mouvement MAGA, et les résultats étaient clairs.
Ce que nous observons maintenant, c’est que MAGA, un mouvement qui s’est formé lors de l’élection de 2016, était en réalité déjà un troisième parti. Le fait est que les idées de MAGA n’ont presque aucune ressemblance avec l’idéologie du Parti républicain. Le Parti républicain actuel est essentiellement celui des néoconservateurs, des mondialistes, des partisans d’un monde unipolaire, des interventions au Moyen-Orient, de la guerre contre la Russie jusqu’à sa défaite stratégique, et des réductions d’impôts pour les riches. C’est la politique conventionnelle : celle qui convient parfaitement à l’État profond. Ce sont vos Républicains standard. Depuis les années 1980, il n’y a pratiquement plus de paleoconservateurs ou d’isolationnistes comme Pat Buchanan dans le parti. En substance, le Parti républicain est devenu simplement le nationalisme mondial de droite — la droite de l’État profond.
Trump, tant durant son premier mandat qu’aujourd’hui dans son second, est arrivé au pouvoir avec des idées radicalement différentes — des idées qui n’ont que le plus ténu lien avec le Parti républicain tel qu’il est aujourd’hui. Bien sûr, il existe quelques politiciens comme Marjorie Taylor Greene ou Thomas Massie qui partagent les idéaux MAGA, mais dans l’ensemble, Trump était une figure solitaire dans cette sphère. Alors, qui le soutenait ? Ceux qui sont totalement sous-représentés dans le Parti républicain — ceux qui veulent détruire l’État profond, ceux qui exigent qu’Amérique se retire des guerres étrangères et se concentre sur ses problèmes intérieurs, ceux qui veulent que la élite libérale pédophile, dont les crimes ont récemment été dévoilés, soient justement et sévèrement punis, et ceux qui appellent à l’expulsion des migrants illégaux. Cette force défend deux sexes — pas quarante-huit, comme dans certains États — et le retour de l’Amérique à la raison. Cette force n’est en aucun cas le Parti républicain, et bien sûr pas le Parti démocrate non plus (les démocrates ont causé le plus de mal). MAGA est lui-même le troisième parti. C’est ce que beaucoup ne comprennent pas.
Comme Trump a récemment commencé à s’éloigner de ce troisième parti — MAGA — et à se rapprocher des républicains ordinaires, son soutien s’est effondré. Au début, beaucoup de supporters MAGA s’opposaient à la guerre contre l’Iran et au soutien américain à Israël. Certains, comme Thomas Massie, ont même déclaré que l’Amérique n’était pas dirigée par des Américains, mais par des Israéliens, ce qui a vivement confronté Trump à ce sujet et l’a éloigné de lui. Elon Musk a souligné que Trump avait promis de ne pas augmenter le plafond de la dette — afin de ne pas condamner les générations futures à l’esclavage financier et de « consommer demain aujourd’hui ». Trump a violé cette promesse en faisant adopter le « Big Beautiful Bill ».

Enfin, Trump a répété à plusieurs reprises qu’il publierait les dossiers complets d’Epstein : des documents contenant des preuves de pédophilie et d’orgies rituelles impliquant l’élite politique libérale américaine mentionnée précédemment. Pourtant, il affirme maintenant que de tels dossiers n’existent pas, et que donc, aucune orgie n’a jamais eu lieu. Devant nos yeux, Trump se transforme du leader de MAGA en un républicain ordinaire. Il passe de plus en plus de temps avec le sénateur radical russophobe Lindsey Graham, et il représente de moins en moins les idées qui l’ont fait élire.
MAGA est en désespoir. Voici Elon Musk, un acteur politique très pragmatique. Pensez à combien il a d’argent et combien en a Trump. Musk possède près de 400 milliards, Trump environ cinq milliards. Dans un pays comme l’Amérique, où l’argent a une importance énorme, presque divine, Musk est quatre-vingt fois plus un « dieu » que Trump.
À mon avis, Musk fait un mouvement très délibéré. Le mouvement MAGA a été orphelin ; Trump l’a trahi. Musk soutient à juste titre que c’est ce mouvement qui a porté Trump au pouvoir et qui s’oppose à l’« Uniparty ».
L’Uniparty est ainsi que les supporters de MAGA désignent la collusion entre démocrates et républicains sous la direction de l’État profond — des mondialistes qui peuvent être de droite, comme les néoconservateurs, ou de gauche, comme les soutiens de Biden, mais qui partagent la même ligne de fond. MAGA s’oppose à l’Uniparty.
Donc, si Trump a effectivement été « détourné » — pris en otage par l’Uniparty — une vaste horizon s’ouvre pour poursuivre la mission commencée par le mouvement MAGA. À mon avis, c’est une évolution très intéressante. Jusqu’à présent, toutes les initiatives majeures de Musk — bien qu’accueillies souvent avec horreur et scepticisme — ont réussi. Voyons ce qui se passera ensuite.
12:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maga, donald trump, états-unis, actualité, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Trump et la globalisation du narcissisme politique

Trump et la globalisation du narcissisme politique
Nicolas Bonnal
Donald Trump fait rire tout le monde ou presque, mais Macron, Ursula, Kallas ou Merz beaucoup moins. Ce sont pourtant les mêmes symptômes de détraquement narcissique que l’on peut observer partout. Mon ami Blondet avait dénoncé ces selfies grotesques des pétasses trentenaires, ministresses de la Défense un peu partout en Europe, et prêtes à raser la Russie dans leurs baskets Chanel. Mais le fait que la plupart des dirigeants actuels sont là depuis longtemps et s’accrochent devrait aussi inquiéter tout le monde. Ils sont indélogeables et NE VEULENT PLUS PARTIR: voir Trump, Macron, Sanchez, Z., mais aussi Poutine, Lula, Xi, Modi, etc. la tendance est à la longévité de l’autocrate (disait Mearsheimer de Poutine), et ce où que ce soit. Tout le monde se rêve Bonaparte ad vitam. Netanyahou, homme de l’année et même du siècle, est là depuis trente ans je crois, et sa violence s’accroît avec son âge déjà avancé.


Tout le monde lucide peut observer donc la dégradation psychique de nos dirigeants : mais l’altération est générale, concerne tout le monde, y compris nous, les narrateurs rebelles, et elle accompagne la révolution de la communication technologique qui dégrade notre accès à la connaissance (plus personne ne lit, tout le monde perd son temps sur X et You Tube conçus pour ça aussi sans doute), exaspère nos différents et amplifie nos troubles psychiatriques et notre caractère (je plaide coupable bien entendu).

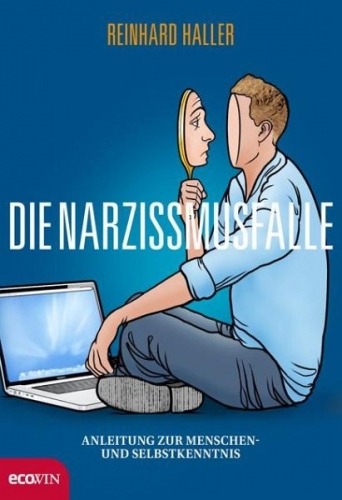
L’excellent site suisse Watson a traduit une interview brève et intense d’un psychiatre allemand qui parle de tout cela en quelques lignes. Je reprendrai sans trop commenter (à chacun de se faire son idée et aussi son autocritique) :
« Le psychiatre Reinhard Haller, spécialiste de renommée mondiale, analyse les traits de personnalité de Donald Trump.
Quels sont les traits qui vous permettent de dire que Donald Trump est narcissique?
Cinq caractéristiques principales ressortent: l'égocentrisme, la vanité, le manque d'empathie, la dévalorisation des autres et la susceptibilité.
Voyons cela en détail, en commençant par l'égocentrisme.
Un narcissique place son propre point de vue au centre de tout. Dans le cas de Trump, son slogan «Make America Great Again» peut être vu comme une vision très autocentrée, laissant peu de place aux perspectives divergentes.
Comment se manifeste la vanité?
Les narcissiques recherchent constamment la reconnaissance et l’admiration. Trump semble particulièrement attentif à son image publique et à l’attention qu’il reçoit. »
NDLR : relire le Petit Prince quand il visite les puissants de ce monde…
Plus importante est la suite car elle concerne tout le monde : nous nous foutons par exemple des souffrances des pays arabes et musulmans martyrisés par l’Occident, nous nous foutons des mutilations des gilets jaunes, des filles violées en Angleterre, et nous nous foutons du nombre de victimes du vaccin: nous sommes devenus comme ça. Paul Nizan disait déjà il y a un siècle que le bourgeois voyait le monde par ses écrans…
Je reprends l’interview :
« Qu'entendez-vous par manque d'empathie?
Ce trait peut se manifester par une apparente indifférence aux difficultés des autres. Certains de ses discours et décisions politiques ont pu donner l'impression d'un faible souci du ressenti des autres. »
Oui, parler de casino à Gaza… Mais passons. Evitons les lourdes condamnations.
On constate aussi chez Trump (comme chez l’Autre en France) une tendance typique des narcissiques à dévaloriser les autres : je plaide coupable car comme je le dis la tendance techno-narcissique concerne tout le monde et j’en parlais déjà dans mon Internet Nouvelle voie initiatique. Internet sert à s’engueuler avait dit un jour Michel Rocard, qui avait été le meilleur premier ministre de la cinquième république - avec un autre socialiste protestant, Lionel Jospin, mal récompensé de sa droiture et de son bilan.
« Comment s'exprime la dévalorisation des autres?
Les critiques semblent souvent déclencher chez lui des réactions très vives, ce qui est caractéristique des personnalités narcissiques. »
Trump ouvre les yeux de tout le monde – enfin, théoriquement… - car il est trop susceptible, devenant ce faisant une cible facile:
« Et qu'en est-il de la susceptibilité?
C'est en quelque sorte son talon d'Achille. Les critiques semblent souvent déclencher chez lui des réactions très vives, ce qui est caractéristique des personnalités narcissiques.

Donald Trump est donc une personne vulnérable?
Les narcissiques paraissent grands et inébranlables de l'extérieur, mais ils ont une peau très fine. La moindre critique les touche profondément, une goutte de pluie a l'effet d'un coup de fouet. Ils ne peuvent tolérer aucun avis différent sans se sentir attaqués.
«Pour se stabiliser, ils dévalorisent les autres. C'est pourquoi ils le font si rapidement: c'est un mécanisme de protection»
On comprend alors mieux les âneries distillées par le pauvre président sur Social Truth et ailleurs. Ajoutons tout de même que Trump a contre lui les médias, médias qui font le jeu de la tyrannie en Europe, comme l’a observé J.D. Vance au cours d’une conférence brillante et déjà oubliée. Trump est moins périlleux que nos autocrates européens belliqueux et autoritaires. Il n’est que narcissique et à peu près impuissant.
Après l’interview devient encore plus intéressante. Car cela concerne tout le monde. Au-delà de Donald-cible-facile, comme dirait un chef sioux.
« Pourquoi la société devient-elle plus narcissique?
Plusieurs facteurs entrent en jeu. Une phrase particulièrement pertinente vient de Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien: peu avant sa mort, il a déclaré que la survie de l’humanité dépendrait de sa capacité à préserver l’empathie.
«Car sur tous les autres plans – intelligence, logique, même créativité – les machines finiront par nous surpasser, si ce n’est déjà le cas»
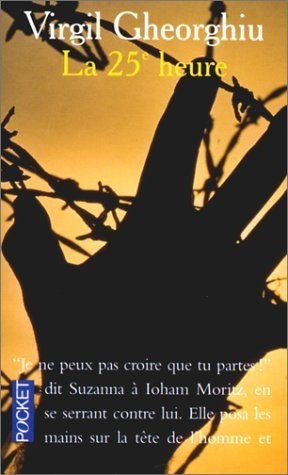 Oui, et on constate que Virgil Gheorghiu avait raison dans sa vingt-cinquième heure : nous pensons en mode machine et nous sommes même moins sensibles que Grok ou ChatGPT. La machinerie de la communication nous a mieux désensibilisés que l’Inquisition (voir Bruckberger) ou le nazisme (Primo Levi). Nous n’en sommes qu’au début. Les bourreaux de Gaza restent des pauvres victimes des holocaustes et de la haine antisémite, et les bourreaux des petites vieilles en Europe des victimes du racisme et de l’extrême-droite.
Oui, et on constate que Virgil Gheorghiu avait raison dans sa vingt-cinquième heure : nous pensons en mode machine et nous sommes même moins sensibles que Grok ou ChatGPT. La machinerie de la communication nous a mieux désensibilisés que l’Inquisition (voir Bruckberger) ou le nazisme (Primo Levi). Nous n’en sommes qu’au début. Les bourreaux de Gaza restent des pauvres victimes des holocaustes et de la haine antisémite, et les bourreaux des petites vieilles en Europe des victimes du racisme et de l’extrême-droite.
Haller ajoute :
« Mais l’empathie, cette capacité à ressentir ce que l’autre ressent, reste une caractéristique fondamentalement humaine. Malheureusement, c’est précisément cette faculté qui est menacée.
Pourquoi?
La communication numérique remplace de plus en plus les échanges en face-à-face. Les emojis et les «likes» ne sont pas de véritables expressions émotionnelles. Les réseaux sociaux encouragent l’autopromotion narcissique et appauvrissent la profondeur des relations humaines. A cela s’ajoute l’idéal de «coolitude» imposé par la société: il faut paraître fort, indépendant, inébranlable. La vulnérabilité, les besoins affectifs, la proximité sont dissimulés derrière un masque. Et plus cette façade est entretenue, plus l’empathie diminue et plus le narcissisme s’accroît. »
La technologie accélère cette insensibilité qui est venue avec le monde moderne. Dans ma dissertation sur Chateaubriand je rappelais avec le Maître (c’est mon moment narcissique, la citation…) :
« Il voit le basculement immoral de l’homme moderne, grosse bête anesthésiée, ou aux indignations sélectives, qui aime tout justifier et expliquer :
« Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale : l’état matériel s’améliore, le progrès intellectuel s’accroît, et les nations au lieu de profiter s’amoindrissent : d’où vient cette contradiction ?
C’est que nous avons perdu dans l’ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes ; mais ils n’étaient point commis de sang−froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps ; si on les jugeait autrefois d’une manière différente, c’est qu’on n’était pas encore, ainsi qu’on l’ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l’homme ; on les analyse actuellement ; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu’on peut en tirer d’utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries. »
Reprenons Haller qui rappelle un de mes génies préférés (n’en déplaise à Guénon) :
« Vivons-nous à l’ère du narcissisme?
Autrefois, dans de nombreuses religions, le narcissisme était considéré comme un péché – une volonté de s’élever à la hauteur des dieux. Sigmund Freud l’a ensuite décrit au début du 20ème siècle comme un trouble psychologique. Aujourd’hui, c'est devenu un idéal social dans bien des domaines: il faut se mettre en scène, se présenter sous son meilleur jour, projeter une image parfaite. »
Après, encore un point essentiel : l’électeur n’est pas victime de la propagande (sinon il n’aurait pas voté Trump par exemple…), l’électeur adore voter pour le sociopathe qui lui ressemble (on ne citera personne) – et Haller d’expliquer pourquoi :
« Pourquoi les gens choisissent-ils de plus en plus des dirigeants narcissiques?
Nombreux sont ceux qui trouvent fascinant quelqu’un qui transgresse toutes les règles. Quelqu’un qui affirme: «Les lois sont pour les faibles», «Toute critique est une fake news», «Plutôt construire un mur que discuter». Ces solutions simples et autoritaires impressionnent – en particulier ceux qui aimeraient eux-mêmes pouvoir agir ainsi, mais qui n’en ont pas la possibilité. Ce qui m’a cependant surpris lors des dernières élections américaines, c’est que les électeurs de Trump provenaient de tous les milieux sociaux – y compris parmi les intellectuels et les scientifiques. Cela a ébranlé mon hypothèse selon laquelle le narcissisme ne trouverait un écho que dans certains segments de la population. »

Ces « lois qui sont faites pour les faibles », cela rappelle furieusement les sophistes et le phénoménal Calliclès de Platon : le discours politique nourrit le narcissisme et il est constitutif de la logique politique en occident. Mais passons.
Oui plus le dirigeant occidental (c’est clairement le pire en ce moment, et je répète que Trump n’est pas le pire) est empreint de Chutzpah, plus il est adoré et réélu.
Le reste est chez Guy Debord : « Qui a pu en faire tant sans peine ira forcément plus loin. On ne doit pas croire que puissent se maintenir durablement, comme un archaïsme, dans les environs du pouvoir réel, ceux qui n’auraient pas assez vite compris toute la plasticité des nouvelles règles de leur jeu, et son espèce de grandeur barbare. Le destin du spectacle n’est certainement pas de finir en despotisme éclairé."
Sources principales :
https://numidia-liberum.blogspot.com/2025/07/usania-un-pa...
https://www.watson.ch/fr/international/donald-trump/56330...
https://www.dedefensa.org/article/chateaubriand-et-la-con...
https://www.profession-gendarme.com/la-25eme-heure-et-la-...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chutzpah
« Chutzpah peut être utilisé pour exprimer l'admiration envers un culot non-conformiste. Cependant, dans Les Joies du Yiddish, l'expression est illustrée par l'histoire du parricide implorant l'indulgence du tribunal en s'exclamant : « Ayez pitié d'un pauvre orphelin ».
https://achard.info/debord/CommentairesSurLaSocieteDuSpec...
https://xn--lerveildesmoutons-dtb.fr/entretien-avec-nicol...
https://www.dedefensa.org/article/nizan-et-les-caracteres...
12:28 Publié dans Actualité, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, psychologie, narcissisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 juillet 2025
Le troisième parti d'Elon Musk a-t-il une chance? Trump n'y croit pas

Le troisième parti d'Elon Musk a-t-il une chance? Trump n'y croit pas
Par Robert Bridge
Le président américain a sévèrement critiqué son ancien conseiller après que le magnat de la technologie a annoncé son intention de financer le soi-disant America Party.
L'homme le plus riche du monde a annoncé la création de l'America Party dans une série de messages publiés récemment sur X, anciennement Twitter, le réseau social qui fait partie de son empire privé.
«Quand il s'agit de ruiner notre pays avec le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie», a déclaré avec défi le Sud-Africain.
«Aujourd'hui, l'America Party est créé pour vous rendre votre liberté».
Musk, qui a été choisi pour réduire les dépenses fédérales par le biais du Department of Government Efficiency (DOGE) créé par Donald Trump, a critiqué ouvertement le « grand et beau projet de loi » (BBB) du président, qui, selon le Congressional Budget Office, un organisme non partisan, augmenterait le déficit national de 3300 milliards de dollars (2850 milliards de livres sterling) d'ici 2034.
Les opposants au « BBB » affirment qu'il prévoit d'importantes réductions d'impôts pour les plus riches, tout en réduisant les programmes sociaux fédéraux, ce qui priverait près de 11 millions de personnes de leur assurance maladie.
Les deux hommes se sont affrontés sur le coût et les conséquences du projet de loi depuis que Musk a quitté le gouvernement en mai. Vendredi, lorsque Trump a promulgué son projet de loi lors d'une cérémonie organisée à la Maison Blanche pour célébrer le 4 juillet, Musk a lancé un sondage sur X: « C'est le moment idéal pour vous demander si vous voulez vous affranchir du système bipartite (certains diront unipartite) ».
Les répondants se sont prononcés à deux contre un en faveur du projet, a annoncé Musk. Il n'a donné que peu de détails aux journalistes sur la structure de son prochain grand projet ou sur le calendrier de son développement futur. Mais ses précédents messages suggéraient qu'il se concentrerait sur deux ou trois sièges au Sénat et huit à dix circonscriptions à la Chambre des représentants.
C'est une idée plutôt ingénieuse, étant donné que les deux chambres du Congrès sont contrôlées par les républicains avec une faible majorité.
« Compte tenu de la marge législative très étroite, cela suffirait pour faire pencher la balance sur des lois controversées, garantissant ainsi qu'elles reflètent la véritable volonté du peuple », a expliqué Musk de manière raisonnable.
Trump a tourné en dérision la décision de son ancien meilleur ami de créer et de financer un nouveau parti politique américain, la qualifiant de «ridicule». «Les tiers partis n'ont jamais fonctionné, il peut donc s'amuser avec ça, mais je trouve cela ridicule», a déclaré le président aux journalistes qui l'accompagnaient dans son hélicoptère Marine One pour retourner à la Maison Blanche après une journée passée à frapper des balles de golf.
Il a ensuite développé son propos, avec la verve qui lui est propre, dans un message publié sur sa plateforme de réseaux sociaux, Truth Social. «Je suis attristé de voir Elon Musk dérailler complètement, devenant essentiellement un TRAIN EN DÉRAILLE depuis cinq semaines », a écrit le président. « Il veut même créer un troisième parti politique, alors que cela n'a jamais fonctionné aux États-Unis ».
« La seule chose pour laquelle les tiers partis sont bons, c'est de créer une RUPTURE et un CHAOS complets et totaux », a ajouté Trump. Le président a ensuite affirmé que le patron de Tesla et SpaceX était motivé par son mécontentement face à son projet de mettre fin aux subventions visant à promouvoir l'achat de véhicules électriques.
Musk ne s'est toutefois pas laissé décourager par la longue tirade du président américain, arguant de manière plutôt naïve qu'il ne serait « pas difficile » de briser l'emprise des démocrates et des républicains sur la politique américaine. Il a ensuite demandé « quand et où nous devrions tenir le congrès inaugural du Parti américain. Ce sera super amusant ! »
Mais le milliardaire comprend-il vraiment la profondeur du marécage dans lequel il s'enfonce ? Selon des estimations prudentes, Musk a déboursé environ 275 milliards de dollars de sa fortune personnelle pour faire élire Trump pour un second mandat lors de la course à la présidence de novembre dernier. Si cela n'est qu'une goutte d'eau pour le magnat, il devra dépenser beaucoup plus pour bouleverser la structure du pouvoir sclérosée qui domine actuellement le Capitole (bien qu'il ne soit pas obligatoire pour les nouveaux partis politiques américains de s'enregistrer auprès de la Commission électorale fédérale (FEC) au début du processus, les obligations de déclaration commencent dès que les dépenses dépassent ce que la FEC appelle « certains seuils »). Et avouons-le, Trump a raison. Les États-Unis n'ont jamais bénéficié d'un troisième choix pendant très longtemps, et lorsque cela s'est produit, le succès a été très limité.
À quelques exceptions près, le système politique américain est dominé par deux grands partis qui remportent en moyenne 98% des sièges au niveau fédéral et dans les États.
« Les États-Unis se distinguent des autres démocraties dans le monde par le nombre exceptionnellement faible de partis compétitifs », écrit Seth Masket dans Democracy. «Dans une société aussi vaste, diversifiée et multiethnique, le fait qu'il n'y ait que deux partis dominants signifie que ces partis seront des coalitions extrêmement vastes, complexes et hétérogènes».
Musk devrait connaître la loi de Duverger, qui stipule que dans les systèmes politiques à circonscriptions uninominales et à scrutin majoritaire à un tour, comme aux États-Unis et en Grande-Bretagne, seuls deux partis politiques puissants ont tendance à contrôler le pouvoir. Les citoyens sont encouragés à ne pas voter pour des tiers qui pourraient faire perdre des voix aux grands partis. Un tel modèle s'écarte fortement du système européen, où les citoyens sont activement encouragés à créer, rejoindre et voter pour de nouveaux partis politiques s'ils ne sont pas satisfaits des choix actuels. Une telle façon de penser est pratiquement inconnue aux États-Unis.

Et essayez de comprendre cette énigme: lors de l'élection présidentielle américaine de 1992, la candidature indépendante de Ross Perot n'a obtenu aucun vote électoral, malgré 19% des suffrages populaires, le meilleur score obtenu par un candidat présidentiel n'appartenant pas à un grand parti depuis Theodore Roosevelt en 1912. Perot reste le seul candidat présidentiel non issu d'un grand parti depuis George C. Wallace en 1968 à avoir remporté des comtés et à avoir terminé à la deuxième place dans un État.
Et puis, l'America Party sera inévitablement confronté au formidable pare-feu que constituent les médias américains, qui servent fidèlement leurs puissants maîtres, c'est-à-dire les deux têtes du même serpent qui exercent la plus grande influence politique. Mais ce n'est pas tout. Ils sont soutenus par une organisation louche connue sous le nom de Commission sur les débats présidentiels (CPD), une société à but non lucratif créée en 1987 sous le parrainage conjoint des partis politiques démocrate et républicain aux États-Unis. Oui, vous avez bien lu. L'organisation créée pour garantir l'équité et l'égalité d'accès aux différentes ressources (principalement dans les médias) pendant les débats est détenue en totalité par le monopole des deux partis.
En 1985, la Commission nationale bipartisane sur les élections a recommandé de « confier le parrainage des débats présidentiels aux deux grands partis ». La CPD a été créée en 1987 par les présidents des partis démocrate et républicain afin de « prendre le contrôle des débats présidentiels ».
Face à des obstacles aussi redoutables, Elon Musk pourrait bien trouver plus facile d'atteindre la surface de Mars que de briser le système politique américain, construit comme une forteresse à plusieurs niveaux pour se protéger contre les « outsiders » indésirables.
19:40 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, elon musk, america party, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
MAGA contre lui-même

MAGA contre lui-même
par Georges Feltin-Tracol
Animateur-vedette d’une émission de télé-réalité de 2004 à 2015, The Apprentice, Donald Trump aurait été observé avec attention et curiosité par Guy Debord. Sa maîtrise des codes médiatiques qu’il détourne et dévoie volontiers suscite un intérêt constant sur sa personne. Cet attrait médiatique toujours renouvelé lui est plus que jamais nécessaire alors que les premières fissures apparaissent dans le mouvement MAGA.
Hostile par essence au Système, le trumpisme catalyse un ensemble hétéroclite de revendications souvent disparates. Sa désignation de l’ennemi principal collectif, à savoir l’« État profond », les démocrates corrompus et le wokisme, ne suffit plus à masquer de profondes et graves divisions latentes en son sein. Les sept premiers mois du second mandat de Donald Trump ont déjà connu trois fortes secousses qui fragilisent une coalition pas si unanime que l’on croit.

La première s’ouvre très tôt, avant même l’investiture officielle du 20 janvier 2025, quand Elon Musk et les techno-hiérarques ralliés à Trump affrontent Steve Bannon et la tendance nationaliste populaire à propos du visa H1 - B. Les autorités étatsuniennes l’accordent aux ingénieurs étrangers ultra-qualifiés désireux de venir aux États-Unis à la demande d’entreprises en pointe dans leur secteur. Musk en a naguère bénéficié. Il estime par conséquent insensé et vain d’abolir ou de restreindre ce visa. La Tech a sans cesse besoin d’ingénieurs venus du monde entier. Sur X, Elon Musk se justifie. Pour lui, « amener via l’immigration légale le top 0,1 % des talents en ingénierie est essentiel pour que l’Amérique continue à gagner ». Cette vive réaction des cénacles technophiles confirme l’analyse de Robert de Herte (alias Alain de Beniost) et de Hans-Jürgen Nigra (alias Giorgio Locchi) dans « Il était une fois l’Amérique », le célèbre essai paru dans le double numéro 27 – 28 de Nouvelle École en automne – hiver 1975. « Aux États-Unis, écrivaient-ils, la civilisation, privée de son ” contexte ” et de sa substance, n’a pu se renouveler que par un apport extérieur constant, fourni par la vague migratoire la plus récente. Cet état de fait ne s’est pas modifié jusqu’à nos jours. Si l’on prend la peine de faire la distinction entre la découverte et l’invention (la seconde n’étant qu’une application de la première), on s’aperçoit, avec le recul du temps, de la profonde stérilité des États-Unis. L’Amérique n’a jamais créé. Elle est stérile par nature. Forte de sa richesse et de ses moyens matériels, elle peut seulement développer (par des “ inventions “) là où les autres ont innové. » Les étrangers récemment naturalisés comprennent mieux cette réalité que les Étatsuniens de vieille souche qui ont oublié qu’ils viennent eux aussi d’ailleurs. Donald Trump tranche finalement en faveur du visa H1 - B parce sa vision demeure profondément utilitariste.
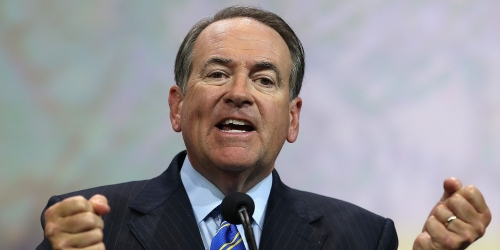
La deuxième césure s’ouvre, il y a une quinzaine de jours, au sujet de l’opération militaire contre l’Iran. Très tôt, deux factions de MAGA s’invectivent en interne. Les chrétiens sionistes, souvent issus des milieux évangéliques protestants, dont la figure de proue est Mike Huckabee (photo), l’actuel ambassadeur en Israël et ancien gouverneur de l’Arkansas (1996 - 2007), retrouvent pour l’occasion leur néo-conservatisme interventionniste. Tenants résolus du Grand Israël dans une perception parousique, ces chrétiens sionistes s’activent par-delà le bombardement des sites nucléaires iraniens au changement de régime à Téhéran, quitte à y déployer des troupes étatsuniennes au sol.

Cette perspective révulse leurs contradicteurs parmi lesquels la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene (photo) et le journaliste Tucker Carlson. Ces derniers prônent l’Amérique d’abord, la concentration des efforts contre l’immigration et les infrastructures occultes - wokistes de l’État fédéral. Ils jugent avec raison à l’aune de l’expérience acquise en un quart de siècle de la vacuité et de l’inanité de toute intervention militaire terrestre en faveur de la piteuse démocratie égalitaire de marché.
Comment le 47e président des États-Unis allait-il s’extraire de ce débat tendu et déstabilisateur sans perdre son crédit et son aura auprès de son électorat ? En étant l’élève de Patrick Buchanan ! Au lendemain du 11 septembre 2001, l’essayiste paléo-conservateur critiquait les intentions chaotiques des néo-conservateurs. Il proposait des frappes aériennes chirurgicales sur les centres de commandement talibans et d’Al-Qaïda en Afghanistan sans toutefois engager le moindre gars des Grandes Plaines ou des Appalaches. La Maison Blanche ne le suivit pas. En revanche, Donald Trump oui. Certes, il a ordonné des frappes aériennes, mais il a aussitôt réfuté toute révolution intérieure fomentée depuis l’étranger. Donald Trump a enfin exigé d’Israël l’arrêt immédiat de son agression aérienne. Le dirigeant étatsunien a ainsi satisfait les deux parties antagonistes de son camp.
L’actuel président des États-Unis n’éprouve pas la même patience à l’égard de la nouvelle fracture béante survenue à la suite de son projet gigantesque de budget fédéral. En effet, ce qu’il appelle la « grande et belle loi » prolonge des crédits d’impôts colossaux adoptés lors de son premier mandat, élimine l’imposition sur les pourboires (une promesse de campagne !), permet des réductions fiscales sur les heures supplémentaires et les prêts automobiles, et accorde des milliards supplémentaires contre l’immigration illégale et pour la défense, le secteur de l’armement et la construction du « Dôme doré » (le système pan-américain de défense anti-missile). Après un premier vote favorable étriqué à la Chambre des représentants, le Sénat l’a adopté de justesse (51 contre 50) grâce à la voix déterminante de son président, le vice-président J. D. Vance. Le texte revient maintenant devant la Chambre des représentants.

Elon Musk exprime toute sa colère envers ce projet de loi budgétaire, pierre angulaire du programme économique du président, qui prévoit plusieurs milliers de milliards de dollars. Sa critique féroce attise le mécontentement des libertariens et des techno-hiérarques. Adepte de la règle d’or budgétaire, le sénateur libertarien du Kentucky, Rand Paul (photo), dénonce un déficit abyssal prévisible. Une instance impartiale du Congrès, le Bureau du budget, estime que ce projet financier risque d’augmenter la dette publique de plus de 3400 milliards de dollars d’ici à 2034. Au matin du 3 juillet dernier, cinq représentants républicains exprimaient encore leurs réticences à voter cette proposition de budget faramineuse en seconde lecture.
Les commentateurs se focalisent sur l’abandon des incitations fiscales favorables aux énergies renouvelables ainsi que sur la diminution draconienne des aides sociales (Medicaid, le programme public d’assurance – santé pour les plus faibles revenus et le programme alimentaire SNAP destiné aux plus défavorisés). Mais, à part la Californie et le Massachusetts où les législations sociales se rapprochent le plus des États sociaux-démocrates européens, le rabotage de ces aides reste assez bien perçu, y compris et surtout auprès des populations les plus précaires. C’est sur le principe même du refus moral de l’endettement – vieux héritage calviniste puritain – que se cristallise la rébellion d’une partie de MAGA.
Les sénateurs et les représentants républicains récalcitrants irritent Donald Trump. Il les menace en retour de leur présenter aux primaires à venir des candidats ultra-trumpistes. Les pressions présidentielles ont réussi ce 3 juillet puisque la chambre basse adopte le méga-budget par 218 votes pour et 214 votes contre dont seulement deux élus républicains réfractaires. Ce nouveau succès renforce l’audience de Trump auprès de son électorat qui conserve sa solidité dans la perspective des élections de mi-mandat à l’automne 2026.

Résultat ? Les tensions entre Trump et Musk s’aggravent au point que la rupture paraît désormais consommée, irrémédiable et définitive. Trump envisage à haute voix de retirer toutes les subventions fédérales aux diverses entreprises de Musk, voire de l’expulser, car l’homme le plus riche du monde possède les nationalités étatsunienne, canadienne et sud-africaine. En réaction, Musk pense lancer à partir de l’influence incroyable de son réseau social X un nouveau parti : le Parti de l’Amérique. Parviendra-t-il à fracasser le plafond d’acier du bipartisme en sachant que les règles électorales et politiques de nombreux États fédérés empêchent sciemment l’émergence dans la durée de toute tierce candidature non marginale ?
Il devient évident que les divergences ne vont que s’accroître à l’intérieur du mouvement MAGA d’autant qu’il reste encore trois ans et demi d’une présidence erratique et égotique. La discorde chez les trumpistes n’en est donc qu’à ses balbutiements.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 164, mise en ligne le 9 juillet 2025 sur Radio Méridien Zéro.
18:45 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, elon musk, donald trump, maga |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 juillet 2025
Trump bat en retraite...

Trump bat en retraite...
Douguine révèle la crise américaine et le rôle de la Russie en tant que Katechon
Alexander Douguine
Alexander Douguine dévoile le recul idéologique de Trump et le campe comme une trahison de sa mission civilisationnelle, met en garde contre une bataille eschatologique croissante entre le mondialisme et la résistance multipolaire, et exhorte la Russie à se dresser, en tant que Katechon, contre la vague antichrétienne.
Sur la base de plusieurs de mes récents messages sur Telegram, certains ont conclu que j'étais déçu par Trump. Mais ce n'est pas tout à fait exact. J'ai observé l'évolution de Trump, la formation de son idéologie – ce que j'ai appelé le trumpisme – de plus près et avec plus d'attention que je n'ai suivi la politique de n'importe quel autre pays. Toute l'histoire de la deuxième campagne électorale de Trump a en fait été une véritable révolution, car les idées qu'il a exprimées – que ses partisans ont promues et approfondies, trouvant un écho auprès de la population américaine – formaient une vision du monde très cohérente. Il s'agissait d'une véritable idéologie, et pas seulement d'une série de slogans.
En reliant les différentes déclarations et positions de ce programme, j'en suis arrivé à la conclusion que le trumpisme possède un noyau idéologique assez solide. Trump a proposé une vision du monde complètement alternative, en contraste flagrant avec celle des mondialistes et des libéraux. Son orientation était non libérale et anti-mondialiste, centrée sur un État civilisationnel fort – l'État-civilisation américain – avec des calculs économiques, des éléments de politique étrangère et même un programme idéologique interne correspondants. Cela incluait l'opposition au mouvement LGBTQ, qui est interdit en Russie, et à d'autres aspects de la culture « woke », ainsi que l'annulation de la « cancel culture » elle-même.
Tout cela a été clairement articulé dès les premiers jours de la présidence de Trump. C'est précisément en étant exposé à cet élément idéologique que j'ai eu l'impression qu'il était comme un brise-glace, fracassant la mer gelée de la dictature mondialiste-libérale. Trump faisait cela depuis le centre même, depuis la « salle de contrôle » principale du système. Naturellement, cela m'a fortement impressionné, d'autant plus que je suivais cela en temps réel à travers des publications, des interviews, des conversations et des livestreams. Trump a gagné en surfant sur cette vague et a initialement agi conformément à ce programme.
L'impression était profonde. Bien sûr, l'Amérique n'est pas une société traditionnelle. Une telle société n'y a jamais vraiment existé. L'Amérique est une expérience de la modernité. Oui, avec toutes ses limites évidentes, et avec l'implication de la droite technologique (Tech Right) représentée par Elon Musk et Peter Thiel, dont les opinions sont souvent étranges et extravagantes, et même avec le populisme national de Steve Bannon, exprimé sans détours. Naturellement, rien de tout cela ne nous appartient vraiment. En principe, il n'y avait là rien qui puisse nous séduire. Pourtant, cela s'opposait – et s'oppose toujours – directement au cours précédent de l'administration américaine.

Lorsque nous abordons Trump et le trumpisme à l'aune de notre propre civilisation, tout cela semble souvent monstrueux et effrayant. Pourtant, comparé au libéralisme et au mondialisme, que les États de l'Union européenne incarnent encore par inertie, cela ressemblait à une révolution conservatrice.
Ce n'est pas un hasard si Macron, s'exprimant lors d'une session de la Grande Loge maçonnique de France, a déclaré une guerre idéologique au « Dark Enlightenment » (les « Lumières obscures ») représenté par Trump. Macron l'a fait au nom de ce que les francs-maçons, les libéraux, les mondialistes, les pervers et les "parades de la fierté" proclament comme étant le « Light Enlightenment » (les « Lumières lumineuses »). En d'autres termes, la lame a rencontré la pierre.
Pourtant, le mondialisme libéral habituel qui a régné sur l'Amérique et le monde au cours des dernières décennies a reçu un coup sérieux de la part de Trump. Il a apporté avec lui une nouvelle idéologie – floue à certains égards, mais très attrayante à d'autres: valeurs traditionnelles, rejet des interventions à l'étranger, rejet des néoconservateurs, renversement complet du programme libéral-démocratique du Parti démocrate, avec toutes ses dégénérescences et sa chute normative et obligatoire vers la décadence. Cela nous était et nous est toujours sympathique.
Mais avec le temps, Trump a commencé à se détourner de tout cela. Il a commencé à perdre les membres de son équipe d'origine. Il s'est rapproché des néoconservateurs, comme lors de son premier mandat. Il n'a pas condamné le génocide de Netanyahu à Gaza. Il a soutenu l'opération militaire israélienne de douze jours et, de plus, les bombardiers américains ont eux-mêmes frappé l'Iran souverain. Aujourd'hui, il prépare le renversement du régime Velayat-e Faqih dans ce pays. En bref, il agit de manière contraire à ce qu'il avait promis et aux attentes de ceux qui ont voté pour lui. Car les gens qui ont voté pour lui voulaient autre chose. Cela a une grande importance.


Cependant, le mouvement MAGA reste très fort. Peut-être qu'Elon Musk en deviendra le nouveau porte-drapeau. Il a déjà proposé de créer un troisième parti en Amérique, et, compte tenu de ses ressources, cela est loin d'être naïf. Thomas Massie (photo), un partisan constant de Trump et un paléoconservateur convaincu, s'est fermement prononcé contre l'intervention en Iran et est déjà en train de devenir une figure clé d'un autre courant du mouvement MAGA. Massie et Musk se rapprochent actuellement, ce qui est également très intéressant. Dans le même temps, Peter Thiel, l'un des architectes de la victoire de Trump, tient des propos très sombres et très justes : le mondialisme est l'idéologie de la civilisation de l'Antéchrist. D'ailleurs, même Marco Rubio a déclaré que les Iraniens attendaient l'arrivée imminente de l'Imam Mahdi, qui annonce la fin des temps.
Nous assistons donc à une nouvelle configuration politico-théologique et eschatologique très intéressante. C'est pourquoi nous devons rester calmes et commencer à étudier en profondeur la philosophie, la religion, l'eschatologie et la géopolitique, de manière beaucoup plus sérieuse que ne le fait actuellement notre communauté d'experts, qui se contente d'effleurer la surface et de tout réduire au prix du pétrole. L'heure est venue de procéder à une analyse approfondie, et non de déclarer que l'on est séduit ou déçu par Trump.
Nous nous trouvons dans une situation où les États-Unis et ceux qui les dirigent aujourd'hui définissent les principales tendances mondiales. Il existe une autre puissance, la Chine, et puis il y a nous. Il n'y a pratiquement aucune autre puissance véritablement souveraine dans le monde. Nous avons notre propre projet de monde multipolaire, et nous cherchons à le construire avec la Chine. C'est une réponse sérieuse, mais le leadership mondial appartient toujours aux États-Unis. Ni idéologiquement, ni militairement, ni technologiquement, ni économiquement, nous ne pouvons – même avec la Chine – renverser ce leadership. Par conséquent, ce qui se passe en Amérique revêt une importance considérable pour nous.

Bien sûr, pour vraiment comprendre tout cela, il faut connaître et comprendre l'histoire de l'Occident et la philosophie de René Guénon, Julius Evola, Nikolai Danilevsky, Lev Tikhomirov et Oswald Spengler. Il faudrait une demi-vie pour assimiler pleinement ces textes. Sans eux, on ne comprend absolument rien, ni à ce qui se passe en Amérique, ni à ce qui se passe chez nous. Nous ne devons donc pas nous fixer des tâches impossibles. C'est la responsabilité de ceux qui ont les compétences et la préparation nécessaires. Nous entrons véritablement dans une sphère où beaucoup de choses vont choquer l'esprit ordinaire.
C'est pourquoi mon analyse doit être abordée différemment. Il ne s'agit pas d'être « déçu par Trump » ou « enchanté par Trump ». Ces catégories n'ont aucune signification pour moi. Je suis un patriote russe et, pour moi, la Russie est une valeur absolue. Je considère tout du point de vue de mon pays, de ma civilisation et de sa mission eschatologique en tant que Troisième Rome, le Katechon, qui empêche le monde de tomber sous le règne de l'Antéchrist. C'est ce qui importe le plus.
14:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, donald trump, états-unis, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 juillet 2025
La paix contre un certain silence: le deal de Candace Owens avec Trump

La paix contre un certain silence: le deal de Candace Owens avec Trump
Trump a personnellement demandé à Candace Owens d’arrêter son enquête pour garantir la coopération de Macron dans les négociations de paix en Ukraine.
Alexander Douguine
(2 juillet 2025)
L’une des journalistes et blogueuses les plus populaires aux États-Unis, Candace Owens, vient de partager une histoire incroyable. Il y a environ neuf mois, elle avait commencé à enquêter sur des affirmations selon lesquelles la femme de Macron, Brigitte, ne serait pas une femme mais un homme. Tout est possible de nos jours.
Tout le monde a vu que Brigitte aurait frappé Macron. Ce n’est pas une preuve, bien évidemment, tout comme le fait qu’il soit apparu à un sommet de l’OTAN en étant débraillé et déséquilibré (comme s’il avait encore été frappé). On peut toutefois se rappeler comment Boris Johnson se comportait. Mais lui aussi était queer.
L’enquête de Candace était plus sérieuse — elle argumentait avec des photos, des documents et de très nombreux témoignages. Il y avait même une théorie, appuyée par une photo convaincante, selon laquelle Brigitte serait un Néandertalien!!
Les deux avocats de Macron ont cité Candace, mais devant un tribunal américain, ce qui ne l’impressionne pas — elle est une héroïne nationale, et l’Amérique l’aime. Maintenant, Candace a révélé pourquoi elle a soudainement arrêté l’enquête.
Il s’avère que Trump (qu’elle avait fortement soutenu lors de son élection) l’a appelée et lui a demandé d'abandonner l'enquête parce que Macron refusait d’aider Washington à négocier la paix en Ukraine ou de cesser de soutenir Kyiv, ce que Trump souhaitait.
Candace, qui est plutôt hostile à Zelensky, a accepté de mettre un terme à son enquête et de ne plus accuser implicitement Brigitte d’être un homme: le tout pour le bien de la paix. Elle a tout expliqué dans une vidéo récente.
Hier, 1 juillet, Macron a appelé Poutine après une longue pause, soi-disant parce que les "vérités si dures" que Candace répandait l’avaient blessé pendant de longs mois. Quand elle s’est arrêtée, il était aussitôt prêt pour négocier la paix. Mais, palsambleu, dans quelle réalité vivons-nous ?
16:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, candace owens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 juillet 2025
Une guerre pour sauver le dollar

Une guerre pour sauver le dollar
Par Jürgen Elsässer
Source: https://www.compact-online.de/ein-krieg-um-den-dollar-zu-...
Le retournement brusque du président américain, qui, en un tourne-main, est passé du statut de président de la paix à celui de fauteur de guerre, a, outre la pression du lobby israélien, des raisons économiques: les États-Unis sont en faillite.
Le problème principal des États-Unis n'est pas la dette en soi (actuellement 37 billions de dollars), elle qui était au centre du conflit entre Donald Trump et Elon Musk : ce dernier voulait la réduire résolument, le premier la freinait.
Le vrai problème est plutôt ladite "dette extérieure nette", c'est-à-dire la différence entre les dettes envers l'étranger et les créances propres sur l'étranger: celle-ci atteignait déjà en 2021 18 billions de dollars, soit près de 80% du produit intérieur brut annuel. À titre de comparaison: en 1989, la RDA était considérée comme en faillite parce que sa dette envers l'Ouest représentait 16% du PIB annuel. En réalité, aucun investisseur responsable ne voulait plus prêter de l'argent à "l'Etat socialiste allemand des ouvriers et des paysans". Mais dans le cas des États-Unis, la dette publique et le déficit commercial ne sont pas une raison suffisante pour les milliardaires et fonds du monde entier de ne plus investir leur argent aux États-Unis… Ce qui semble fou a une raison plausible: le gouvernement américain peut, contrairement à celui de tout autre État débiteur, promettre aux acheteurs de ses titres d’État de les forcer à tout moment et en tout lieu, par la force militaire, à échanger ces papiers sans valeur contre des marchandises.
Des pays comme l’Irak sous Saddam Hussein ou la Libye sous Khadafi, qui menaçaient de ne plus facturer leurs ventes de pétrole et de gaz en dollars mais en monnaies concurrentes, ont été déclarés "États voyous" et liquidés militairement. Actuellement, la même menace plane sur l’Iran, qui possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole et de gaz, et qui fournit également ces énergies fossiles en grande quantité à la Chine, principal rival des États-Unis. La protection d’Israël, les armes de destruction massive — tout cela n’est que propagande. Quand les Anglo-Américains parlent des droits de l’homme, ils pensent en réalité aux droits d’exploitation.

L’impérialisme du papier-monnaie
La politique étrangère américaine se trouve face à un dilemme: le billet vert n’est plus garanti par l’or ou par une performance économique réelle, mais seulement par la force militaire brute. Plus l’économie américaine sombre dans le rouge, plus la politique étrangère sera agressive pour encaisser les dettes et faire taire les créanciers. En même temps, cette posture de plus en plus agressive a modifié la structure des créanciers des États-Unis: les banques d’État de Chine et du Japon, qui, il y a 15 ans, détenaient la majorité des bons du Trésor américain, se sont depuis éloignées de leurs papiers dollar. Elles ont été remplacées par des clients non étatiques: super-riches du monde entier et fonds souverains comme Blackrock. La Fed peut continuer à construire sur ces "rochers noirs".
Mais de nombreux investisseurs du Sud global et de la sphère BRICS sont devenus nerveux, après que les États-Unis (tout comme l’UE) ont gelé les avoirs des riches Russes (et pas seulement de l’État russe). Une telle expropriation de grands investisseurs n’avait auparavant été vue que dans des États socialistes. Depuis, les titres américains ne sont plus un refuge sûr pour les magnats de la finance — cela prive le moteur perpétuel de l’enrichissement américain de sa base.

Dans COMPACT magazine, n°12/2024, j’avais déjà abordé ce sujet. Mon article de l’époque se terminait par une réflexion sur les alternatives qui s'offraient à Trump :
"Le chemin hors du piège de la dette mène Trump dans une impasse: il doit soit restaurer la crédibilité militaire des États-Unis (et donc la couverture hors-économique du dollar) après le fiasco en Afghanistan, ce qui pourrait — contre sa volonté — le conduire à des aventures: si ce n’est contre la Russie, alors contre l’Iran ou la Chine. Ou il tente de rallier à nouveau les milliardaires étrangers en s’orientant vers les prétendus "États voyous" du groupe BRICS, en mettant fin au gel illégal des avoirs russes, et en essayant un genre de "Grand Deal" avec Moscou et Pékin. Mais alors, il se retrouve face à Wall Street, à la City de Londres et à Blackrock".
De nos jours, il est évident que Trump a choisi la seconde option, celle de la guerre.
***
Pour en savoir plus sur la crise économique mondiale et l’impératif économique, lisez cette édition spéciale de COMPACT: https://www.compact-shop.de/shop/compact-spezial/welt-wir...
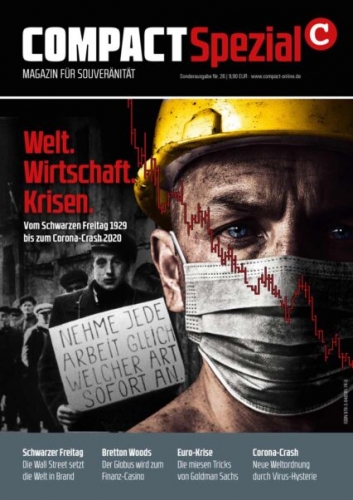
16:55 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, dollar, politique internationale, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 juin 2025
La doctrine du sursaut

La doctrine du sursaut
Jordi Garriga
Donald Trump est président des États-Unis (pour la deuxième fois) depuis le 20 janvier dernier. Et on dirait qu'il a été élu il y a des années : chaque semaine, il nous offre des nouvelles, des gros titres et des raisons de dire, dans un anglais parfait : « What the fuck ! »
Le dernier en date s'est attribué le mérite d'avoir mis fin à une guerre que nous avons déjà surnommée la « guerre des 12 jours » entre Israël et l'Iran. Il n'a pas eu autant de chance avec la guerre en Ukraine, malgré ses appels (y compris des menaces) à la Russie dans des publications accrocheuses sur les réseaux sociaux. Trump possède un côté théâtral qui, bien que caractéristique de son caractère, s'inscrit parfaitement dans la tradition politique américaine : il est populiste, patriote et conservateur. Mais tout cela est commun à plusieurs familles idéologiques de droite aux États-Unis, qui n'ont que peu ou pas de liens avec l'Europe, malgré des tentatives de copier de manière simiesque le discours yankee (voir en Espagne Isabel Díaz Ayuso ou Irene Montero).
La droite américaine privilégie généralement le libre marché, l'individualisme et les valeurs morales traditionnelles. Au-delà de cela, des divergences apparaissent, notamment l'interventionnisme à l'étranger, visant à imposer par la force leurs normes démocratiques, les États-Unis étant une nation choisie par Dieu pour guider l'humanité. D'autres privilégient l'isolationnisme pour une raison tout aussi valable : la démocratie américaine doit tirer parti de sa situation géographique et ne pas s'associer inutilement à des projets étrangers. Trump, avec son slogan « Make America Great Again » (qui peut prendre le sens que chacun juge approprié selon ses idées), a réussi à gagner en unissant ces familles. Une fois élu président, le réalisme politique règne. Et ce qui règne sur la planète, c'est l'émergence d'un ordre multipolaire, avec des acteurs incontrôlables par le seul exercice de la force, de la culture ou de l'économie : la Chine et l'Asie du Sud-Est, avec l'Iran et l'Inde, sont le nouveau centre du monde. L'Europe n'est plus une référence politique, économique, ni même morale: divisée en vingt gouvernements, traînant une dette éternelle, et transformée en laboratoire d'expérimentations sociales. C'est le mur antirusse, et c'est suffisant.
La doctrine du sursaut est l'offensive américaine actuelle : elle impose des sanctions et des récompenses par le biais de droits de douane ; elle fournit et retire son soutien militaire ; elle régule et déréglemente les migrations ; elle cible et retire les organisations terroristes de ses listes ; elle se lie d'amitié avec certaines nations et se crée des ennemis ; elle veut quitter l'OTAN et imposer davantage de dépenses militaires… Les États-Unis changent parfois d'avis ou de perspective (du moins superficiellement) tout en punissant ou en critiquant toute autre nation qui souhaite faire de même.
Le sursaut pour tout gouvernement est d'avoir le soutien des Yankees et de le perdre le lendemain ; le risque est que chaque groupe politique devienne un jour combattant pour la liberté et terroriste le mois suivant (et vice versa) ; il est tour à tour menacé ou loué, de sorte que la réaction à un mode de fonctionnement apparemment aussi insensé est la paralysie, la peur, l'indécision: le choc de ne savoir que faire ou dire. Ou, pour le dire autrement, le contrôle spirituel de telle nation ou de tel groupe.

Et quand quelqu'un ne sait plus où il va, ne sait plus ce qu'il doit faire ou comment se gouverner, c'est l'heure du sheriff mondial, qui lui dira comment être un good boy ou, pire encore, un bon patriote. Personne ne lit ni ne se souvient de ce que George Washington a dit :
« La passion excessive d'une nation pour une autre produit une variété de maux. L'affection pour une nation favorite facilite l'illusion d'un intérêt commun imaginaire là où il n'en existe pas réellement, et instille en elle les inimitiés de l'autre et la pousse à entrer dans ses guerres sans justice ni motif. Elle pousse également la nation favorisée à accorder des privilèges refusés aux autres, ce qui est susceptible de nuire à la nation qui fait les concessions de deux manières : en renonçant inutilement à ceux qu'elle devrait conserver et en suscitant la jalousie, la mauvaise volonté et le désir de vengeance chez ceux à qui elle refuse ce privilège. Elle donne également aux citoyens ambitieux, corrompus ou abusés (qui se placent dans la dévotion d'une nation favorite) la facilité de renoncer ou de sacrifier les intérêts de leur pays sans haine et parfois même avec popularité, dorant une condescendance basse ou ridicule d'ambition, de corruption ou d'engouement sous les apparences d'un sentiment vertueux d'obligation, d'un respect louable pour l'opinion publique ou d'un un zèle louable pour le bien général ».
18:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, soumission, europe, états-unis, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 juin 2025
La dernière bataille: Trump et le destin de l'humanité
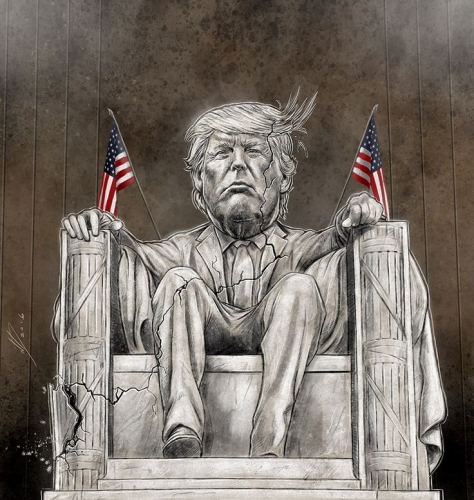
La dernière bataille: Trump et le destin de l'humanité
Alexandre Douguine
Tout semble aller mal, très mal. Trump est tombé dans le piège tendu par les globalistes et les néoconservateurs. Il continue de mener « leur guerre » contre la Russie en Ukraine et s’est maintenant engagé dans une autre « guerre qui n’est pas la sienne » au Moyen-Orient, et il n’y a aucune trace « de sa liste Epstein ».
Mais... malgré tout, le président Trump reste la personne la plus haïe et attaquée au monde, notamment par les réseaux globalistes. Il est en difficulté, et le mouvement MAGA est divisé par les guerres qu’il n’a pas initiées, mais qu’il continue de soutenir et d’alimenter: c’est une erreur fatale. Néanmoins, c’est toujours Trump, et il est en difficulté.
Nous devons être stratégiques. Trump reste une chance pour l’humanité d’éviter la catastrophe finale que nous imposent les globalistes. Il vaut mieux le soutenir, en essayant de corriger et d’améliorer ses erreurs, que de l’abandonner complètement.
Il est clair que les États-Unis n’ont pas besoin de guerres suicidaires. Théoriquement, Trump peut les arrêter. Les autres ne le veulent pas et ne le feront pas. Les globalistes sont pure malveillance. Trump se trouve entre le mal et le bien. Son hésitation entre deux pôles métaphysiques est déjà quelque chose de grand en ces temps très sombres. Il faut faire preuve de patience.
L’État sioniste d’Israël est l’ennemi absolu de l’Iran, des chiites, des Arabes et du monde musulman. C’est leur guerre, et nous devons laisser qu’ils la mènent. Deux eschatologies religieuses opposées se battent entre elles pour Jérusalem, Al-Aqsa et la Palestine. Cela n’a rien à voir avec le christianisme.
15:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 juin 2025
Etats-Unis et Israël: pourrissement cérébral - Entretien avec Alexandre Douguine

Etats-Unis et Israël: pourrissement cérébral
Entretien avec Alexandre Douguine
Propos recueillis par Tatiana Ladaïeva
Tatiana Ladaïeva : Malheureusement, l'escalade au Proche-Orient se poursuit, et le titre de notre émission reflète plus que jamais la situation dans le monde. Commençons par le plus important : le Moyen-Orient. Cela fait déjà quatre jours que les frappes se poursuivent entre Israël et l'Iran. À l'heure actuelle, on rapporte que la défense aérienne iranienne a abattu plusieurs mini-drones au-dessus du nord-est de l'Iran, et qu'une frappe israélienne a endommagé un hôpital dans l'ouest du pays. Il y a des victimes. Il y a quelques minutes à peine, le président iranien a déclaré que les partisans de la production d'armes nucléaires à Téhéran n'avaient pas leur place dans la politique de la république. Faisons un bilan intermédiaire : quels sont les scénarios possibles pour résoudre ou non ce conflit ? Discutons de ce sujet.
Alexandre Douguine : Oui, je pense que c'est actuellement l'événement le plus important, et il s'agit en effet d'une véritable escalade. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde solidarité et ma tristesse face aux pertes subies par l'Iran. Les attaques israéliennes ont détruit le commandement militaire iranien. De nombreux civils ont péri: des physiciens, des scientifiques, des militaires, des chefs militaires ainsi que leurs familles. Nous n'avons pas vraiment insisté là-dessus, mais ils ont tout simplement été anéantis, avec leurs enfants et leurs femmes. Selon les données disponibles ce matin, plus de 70 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été victimes de dommages collatéraux. Or, l'Iran est notre allié, notre ami. Dès le début de l'opération militaire spéciale, il nous a soutenus, tout comme la Corée du Nord. C'est donc un coup très dur pour nous. Ce n'est pas que nous soyons directement impliqués dans cette guerre, mais la sympathie de notre peuple – et, je pense, de l'humanité tout entière – est du côté de l'Iran.
Même en Occident, à en juger par les réseaux sociaux (où il y a plus de liberté que dans les médias mensongers), les gens soutiennent l'Iran. Nous considérons les actions d'Israël au Moyen-Orient – à Gaza, au Liban, en Iran, en Syrie – comme monstrueuses. C'est une manière sanguinaire, cruelle et misanthrope de frapper tout le monde sans distinction, de détruire les dirigeants d'États souverains sans aucune raison. Israël, qui possède l'arme nucléaire, a décidé que l'Iran ne devait pas en avoir et a lancé des frappes préventives, détruisant le commandement militaire d'un pays souverain, frappant des installations nucléaires et tuant des centaines de civils. Cela ne rentre dans aucun cadre, ce ne sont pas des lignes rouges, ce n'est pas la norme, ce n'est pas éthique.

Actualité du jour : Trump, qui avait d'abord soutenu Israël, a été confronté à une vague de franche hostilité de la part de ses propres partisans MAGA. Tout Internet, du moins les réseaux sociaux libres, regorge de demandes visant à mettre fin à l'aide apportée à Israël. « Ce n'est pas ma guerre » est le slogan le plus populaire. Trump, qui venait de promettre d'aider Israël, a changé instantanément de position : il est désormais en faveur de la paix, exige la suspension des hostilités, se souvient comment il aurait mis fin aux conflits entre l'Égypte et l'Éthiopie, l'Inde et le Pakistan, la Serbie et le Kosovo — tout ce qui peut servir à atténuer l'impression qu'il soutient pleinement Israël. Car aujourd'hui, tout le monde déteste Israël. Être son partisan n'est pas considéré comme éthique.
Avant, on pouvait avoir des opinions différentes, mais après Gaza et l'attaque contre l'Iran, c'est trop. L'attaque n'a pas été pas provoquée: depuis 15 ans, on nous répète que l'Iran est sur le point de fabriquer une bombe nucléaire, mais rien ne se passe. Pourquoi y croire maintenant? Il n'y a aucune donnée factuelle. Et Trump dit que Netanyahu lui a demandé l'autorisation d'assassiner l'ayatollah, le chef spirituel de l'Iran, et qu'il a refusé. Vous imaginez ? Des terroristes sévissent à l'échelle mondiale, demandant l'autorisation d'éliminer le chef spirituel, comme au Moyen Âge. Seul Trump, dans sa « miséricorde », l'a interdit. Ce n'est pas une escalade, c'est un cauchemar.
Toutes les notions de droit international s'effondrent. Israël est un État dont le peuple a tant souffert au 20ème siècle. Mais aujourd'hui, toute la légitimité, toute la compassion envers les victimes du régime hitlérien – et les victimes ne sont pas seulement les Juifs, mais aussi les Tsiganes, les Slaves et d'autres peuples – sont balayées par les actions du régime sioniste. Les Juifs du monde entier protestent contre Israël. Les rabbins, les politiciens, les analystes disent : « À bas Israël ». Les actions de Netanyahu sont un crachat au visage du peuple juif, elles renversent le sens de leur sacrifice historique.
Tatiana Ladaïeva : Peut-on préciser s'il y a une possibilité de comprendre ce que Netanyahu veut obtenir en s'opposant à l'Iran, à d'autres pays ? Le conflit dans la bande de Gaza dure depuis 23 ans, oui, c'est compréhensible, l'histoire y est longue. Les tensions avec l'Iran durent également depuis plusieurs années, mais la question est la suivante: si personne ne le soutient, ni Trump, qui tente aujourd'hui de prendre ses distances et cherche des solutions, ni, semble-t-il, son propre peuple, qu'est-ce qui le motive ? Je peux supposer qu'il a peur pour lui-même, qu'il ne veut pas perdre le pouvoir, c'est évident. Mais quand même, que cherche-t-il à obtenir ?
Alexandre Douguine : Pour comprendre ce que Netanyahu cherche à obtenir, nous devons abandonner notre vision habituelle de la politique comme une lutte pour des intérêts, des ressources ou pour l'approbation de la société. C'est une illusion née d'une lecture simpliste et superficielle de la réalité. La politique mondiale est mue par d'autres forces : des idées et des convictions profondes. L'État d'Israël n'a pas été créé simplement comme un projet national, mais comme l'incarnation d'un objectif religieux : la venue du Messie.
Pour les Juifs, c'est la pierre angulaire de leur foi. Cependant, les sionistes, apparus il y a plus d'un siècle, ont proposé une idée controversée : si le Messie, le sauveur qu'ils attendent – sans reconnaître le Christ et le christianisme – tarde à venir, alors il faut prendre sa mission en main.

Le judaïsme orthodoxe interdit catégoriquement le retour en Terre promise et la création d'un État avant la venue du Messie. C'est un principe talmudique, une interdiction absolue. Mais les sionistes ont déclaré : « Nous n'attendrons pas. Nous deviendrons nous-mêmes le Messie ». Ils ont décidé de construire le Grand Israël, ont proclamé Jérusalem capitale et se sont attribué le rôle de messie. C'est là l'essence du sionisme dans sa dimension religieuse. Ben-Gvir, considéré comme un extrémiste, ne fait que donner voix à cette logique: le sionisme n'attend pas l'intervention divine, mais agit ici et maintenant, se substituant au Messie.
Les Juifs sont désormais divisés. Certains ont adopté le sionisme, affirmant: «Nous prenons notre destin en main et faisons ce que le Messie aurait dû faire». D'autres objectent: «Non, il faut attendre. Nous sommes le peuple de l'attente, et la précipitation est une arrogance qui empêche sa venue». J'ai vu des images incroyables: des rabbins à Londres, vêtus de habits hassidiques, brandissant des drapeaux iraniens, appelant à la destruction d'Israël. Ils voient en lui un faux royaume, un simulacre, un précurseur de l'Antéchrist qui éloigne le véritable Messie.
Une telle vision du monde dépasse le cadre d'une politique rationnelle. Israël aspire à régner sur le monde en s'attribuant le rôle du Messie. L'analyse habituelle — intérêts, stratégies, erreurs de calcul — est ici impuissante. Tout s'explique par la métaphysique. Oui, les Juifs ont beaucoup souffert, mais cela ne justifie pas la logique vétérotestamentaire de l'«œil pour œil», selon laquelle un seul coup doit être suivi d'une destruction totale. Les peuples chrétiens, après avoir enduré des souffrances, ont prié pour leurs ennemis, ils ne se sont pas vengés.
L'escalade au Moyen-Orient prend une ampleur eschatologique. Pour les chiites d'Iran, l'Occident et Israël sont l'incarnation du Dajjal, leur Antéchrist. Ils se battent, mais respectent les règles, ne franchissent pas les lignes rouges. Cependant, après avoir perdu à Gaza, au Liban et en Syrie, ils sont obligés de se défendre. Pendant ce temps, les protestants américains et les sionistes chrétiens, l'entourage de Trump, attendent l'invasion du «roi Gog», c'est-à-dire la Russie. Ils nous poussent à soutenir l'Iran pour déclencher une vaste guerre. La Russie condamne Israël, soutient l'Iran, mais le conflit s'étend. Israël affirme avoir détruit un tiers des installations de missiles iraniens, tandis que le Hamas estime que Gaza restera en dehors du conflit. L'ampleur du conflit ne fait pourtant que croître.
En réalité, ils se défendent et, d'ailleurs, ont retiré leurs troupes de Syrie. Cela s'est produit après qu'Abu Mohammad al-Jolani, que beaucoup accusent de travailler pour les intérêts d'Israël, ait mené sa terrible campagne contre Damas, sans parvenir à renverser l'homme politique très raisonnable et modéré qu'est Bachar al-Assad. Les Iraniens se sont comportés de manière étonnamment réservée, malgré leur bellicisme interne, ne franchissant jamais certaines limites. Au contraire, ils ont même discuté avec les Américains de la possibilité de compromis sur l'accord nucléaire. Mais, sans attendre la prochaine réunion, Israël a tout fait capoter par cette terrible frappe — et la guerre a commencé.

Passons maintenant au Pakistan : il fait des déclarations menaçantes, affirmant que si Israël utilise la bombe nucléaire – et tout le monde sait parfaitement qu'Israël en possède –, le Pakistan ripostera par une frappe nucléaire. Ce qui a pu être évité dans le conflit entre deux puissances nucléaires, le Pakistan et l'Inde, redevient une perspective tout à fait réelle. Nous vivons un moment critique. Les explications du comportement des principaux acteurs de cette incroyable escalade ne rentrent plus dans le cadre habituel.
En Occident, on parle de plus en plus souvent d'une troisième guerre mondiale : des publications et des hashtags tels que « #WW3 » apparaissent. De plus en plus de gens comprennent que la situation est allée si loin que les anciennes approches et les explications classiques ne fonctionnent plus du tout. L'ancien ordre mondial s'est effondré, il n'en reste plus rien. Les institutions internationales sont paralysées, leur autorité est réduite à néant.
Les positions politiques changent quotidiennement, ce qui nous oblige à créer une nouvelle carte politologique, ou plus précisément géopolitique. Nous devons prendre en compte ce qui était auparavant ignoré ou sous-estimé: la composante religieuse et les scénarios eschatologiques. Car c'est précisément au Moyen-Orient que convergent aujourd'hui les conceptions les plus diverses sur la fin du monde. Ces idées sont largement répandues tant parmi les protestants américains que dans les cercles du sionisme chrétien. Beaucoup de ses adeptes, y compris dans l'entourage proche de Trump, élaborent leur propre vision de ce qui se passe ou devrait se passer dans cette région. Ils attendent l'invasion du « roi Gog », le « roi du nord », autrement dit la Russie, qu'ils identifient au Gog biblique. Leur calcul est simple: nous soutiendrons l'Iran et entrerons en guerre avec Israël, ce qui leur donnera un prétexte pour déclencher un conflit à grande échelle contre nous. Il s'agit en fait d'une provocation visant à entraîner la Russie dans une escalade.
Il convient de rappeler que Netanyahu a mené des négociations avec Poutine, puis avec Trump. La Russie, quant à elle, adopte une position claire dans ce conflit: elle soutient l'Iran et condamne les actions d'Israël.
Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, je précise que l'armée israélienne a récemment annoncé avoir détruit un tiers des installations de missiles iraniens. Dans le même temps, dans la bande de Gaza, les représentants du Hamas affirment que l'escalade entre l'Iran et Israël ne les affectera pas directement. Cependant, il est évident que l'ampleur du conflit ne fera que s'intensifier.
Tatyana Ladaïeva : Et à propos de Trump : il y a littéralement huit minutes, il a déclaré qu'Israël et l'Iran devaient mener leur conflit jusqu'au bout pour parvenir à un accord. Mais, Alexandre Douguine, lorsque tout a commencé, beaucoup affirmaient qu'Israël agissait sur ordre direct de Trump. Ils disaient que c'était lui qui ne voulait aucun accord avec l'Iran et qui avait presque poussé Israël à agir ainsi. Trump ne devrait-il pas maintenant prendre l'initiative et asseoir Israël et l'Iran à la table des négociations afin de trouver une issue à cette situation ?
Alexandre Douguine : Je pense que le rôle de Trump dans ce conflit est très paradoxal. Il n'est guère l'initiateur de ce qui se passe, car les actions d'Israël sous la direction de Netanyahu suivent la ligne du sionisme religieux d'extrême droite. Trump se retrouve plutôt dans la position d'un otage impliqué dans des guerres qu'il n'a pas déclenchées. Il cherche à jouer le rôle de pacificateur, mais reste néanmoins partie prenante au conflit. À mon avis, il est acculé comme un lièvre: ses déclarations ressemblent davantage à des crises de nerfs qu'à une stratégie mûrement réfléchie. Sa position change quotidiennement: il tente de satisfaire des forces contradictoires, mais ce n'est pas sa volonté propre, c'est une réaction à la pression des circonstances.
En parlant de la guerre au Proche-Orient entre Israël et l'Iran, on ne peut ignorer la position des autres États islamiques. Israël fait preuve d'une prudence et d'une persévérance remarquables — à Gaza et en Irak, il y parvient avec brio. Une question légitime se pose : qui contrôle réellement la situation ? L'Amérique, qui utilise Israël comme un instrument de sa politique, ou Israël lui-même, qui manipule l'Amérique et la communauté internationale dans son propre intérêt ? Si auparavant de telles réflexions étaient considérées comme du conspirationnisme, aujourd'hui la question se pose inévitablement.

Remarquez avec quelle habileté Israël, depuis son invasion terrestre de Gaza, vient à bout de ses adversaires, en s'occupant de chacun d'entre eux individuellement. Après les actions scandaleuses du Hamas, qui ont dépassé toutes les limites imaginables, Israël a répondu par la même monnaie. Son opération contre le Hamas, condamnée par les pays islamiques, a néanmoins contraint les forces régionales à s'abstenir de toute intervention directe.
Après s'être occupé de Gaza – certes pas complètement, mais en recourant à des bombardements intensifs rappelant les pages sombres de la Seconde Guerre mondiale –, Israël s'est tourné vers le Liban et le Hezbollah. Après avoir détruit le leadership de ce dernier, y compris ses fondateurs, il a envahi le territoire d'un État souverain, bombardant sans ménagement des villes pacifiques. La seule véritable résistance est venue des Houthis yéménites, qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel, tandis que les autres États se sont contentés de protester et d'observer la situation.
Aujourd'hui, Israël a frappé l'Iran, un pays qui le dépasse largement à tous égards. L'objectif principal du régime sioniste est clair: empêcher la consolidation des États islamiques en tenant à l'écart les Turcs, les Saoudiens et les pays du Golfe Persique. Israël élimine méthodiquement ses adversaires les uns après les autres, tandis que le monde islamique semble être en transe, fasciné par cette volonté de domination rusée, calculatrice, presque satanique. Ce petit État agressif et fanatique s'en prend aux régimes islamiques, qui se contentent d'observer, invoquant leurs divergences internes ou leurs intérêts économiques. Où est donc cette oumma islamique dont on parle tant ? Dans les épreuves réelles, elle fait preuve de passivité et de désunion. Israël a l'intelligence, la volonté et la détermination fanatique de prendre la place du Messie, tandis que les musulmans semblent absorbés par le commerce du pétrole et les appels au droit international.
Nous pouvons maintenant revenir à Trump — tous ces sujets sont inextricablement liés.
Tatyana Ladaïeva : Oui, tout est vraiment lié. Permettez-moi de résumer les commentaires qui nous sont activement envoyés. Beaucoup se demandent pourquoi ceux qui sont mécontents de Netanyahu et de la politique d'Israël ne résolvent pas leurs problèmes eux-mêmes, sans entraîner les pays voisins dans le conflit. Nous avons déjà abordé cette question. Certains craignent que le silence des autres États ne conduise à une situation où « on est venu me chercher, et personne n'était là pour me défendre ». D'autres voient dans ce qui se passe une motivation économique liée aux intérêts des États-Unis. Ils disent notamment que l'objectif est de faire grimper les prix du pétrole, ce qui profite à l'industrie pétrolière américaine et peut-être à Trump. Nos auditeurs ont différentes hypothèses, mais il semble que nous ayons abordé cette question sous tous ses angles. En ce qui concerne les États-Unis, cela fait déjà trois jours, si je ne me trompe pas, que des manifestations contre le président Donald Trump et son administration ont lieu. Voyons ce qu'est la campagne nationale « No Kings » (« Pas de rois », si l'on traduit littéralement). Elle est directement liée à ce qui se passe aujourd'hui en Amérique.
Alexandre Douguine : En effet, la situation est extrêmement grave. Avant de parler de Trump, il faut aborder le conflit au Proche-Orient. Israël a avancé un argument auprès de l'opinion publique américaine qui n'a pas encore reçu toute l'attention qu'il mérite chez nous, mais qui fait l'objet de discussions partout aux États-Unis, en particulier dans le contexte des manifestations. Il ne s'agit pas seulement de l'opération « Peuple du Lion » contre l'Iran, mais aussi du « choix de Samson ». L'idée est qu'en cas de défaite, si le « Dôme de fer » ne tient pas, Israël est prêt à faire exploser des installations nucléaires dans le monde entier. Ils ont déjà montré comment leurs agents infiltrent même des pays aux régimes répressifs, comme l'Iran: des frappes chirurgicales ont été menées contre ce pays à partir de son propre territoire par des cellules dormantes. Comment cela est-il possible dans de telles conditions? C'est un mystère. Le «choix de Samson» est une image biblique: périr avec ses ennemis. Si Israël commence à perdre, il activera ses cellules à travers le monde et provoquera un apocalypse nucléaire. C'est une perspective sinistre, qui a déjà atteint les Américains et fait partie des discussions autour des manifestations « No Kings ».


Les manifestations « No Kings » (« Pas de rois ») sont une mobilisation des opposants à Trump dans le but de le renverser. Les démocrates, les migrants et les groupes extrémistes tels que l'Antifa appellent à la révolution. Il est curieux de constater qu'Antifa, qui déclare lutter contre le fascisme, reste silencieux lorsque le fascisme se manifeste, par exemple en Ukraine. Il ne s'active que pour renverser les dirigeants qui œuvrent pour le bien de leur peuple, les accusant de « fascisme ». Antifa est le noyau dur de « No Kings », construit sur le modèle des révolutions colorées de Soros. Au lieu du BLM, ce sont désormais les « bérets bruns » latino-américains, qui attisent le séparatisme au Texas et en Californie, et les anarchistes, qui considèrent tout pouvoir comme du fascisme, qui sont à l'avant-garde. Ces radicaux sont les plus agressifs : ils sont armés et provoquent la police. Les démocrates soutiennent ce mouvement. Dans le Minnesota, un partisan des démocrates a abattu la sénatrice S. Harb, son mari et le politicien Hoffman: c'est déjà du terrorisme politique. On parle de guerre civile. Dans le même temps, Trump est accusé d'autoritarisme, comme Poutine ou Orbán, ce qui fait de lui la cible de la révolution.
Les manifestations n'ont pas commencé de manière très intense, peut-être à cause des frappes israéliennes sur l'Iran, qui ont détourné l'attention. Mais Trump est acculé. Il n'a pas apporté la paix en Ukraine, il n'a pas cessé de soutenir le régime de Kiev, échouant ainsi dans la mission pour laquelle il avait été élu. Son soutien à Israël, surtout au début, a déçu ses partisans opposés à tout interventionnisme. Sa position active sur l'Iran s'est soldée par un échec. Échec en Ukraine, soutien aux mesures inhumaines d'Israël et révolte interne: les nuages s'amoncellent au-dessus de lui.
Le rôle d'Elon Musk, deuxième personnalité la plus influente de la politique américaine, est intéressant. Au début, il s'est rapproché de Trump, s'est excusé et a prévu une rencontre. Mais après les frappes contre l'Iran, Musk a changé de discours, voyant le soutien à Trump s'effondrer. Son idée d'un parti « Amérique » a attiré 87% des partisans déçus de Trump parmi ses millions d'abonnés. Dans ce contexte, Trump est poussé dans le rôle d'un fauteur de guerre, comme l'était Biden. Derrière lui se trouvent des personnalités telles que Lindsey Graham, inscrit sur la liste des terroristes par Rosfinmonitoring. Les démocrates, y compris Bernie Sanders, organisateur de « No Kings », condamnent soudainement la guerre et Israël, alors que leur parti l'a toujours soutenu. Ils poussent Trump à commettre des erreurs, puis les utilisent contre lui: c'est une tactique diabolique.
Il est difficile de sympathiser avec Trump: ses déclarations sont contradictoires, sa position change tous les jours. Mais il est le président d'un grand pays, pris en étau entre les protestations, les attentes de ses partisans et ses propres erreurs. Cela ressemble à une crise de nerfs. Il lui reste encore trois ans à gouverner, mais son autorité s'effrite et sa destitution a déjà commencé. Les transgenres, les féministes, les militants LGBT, des groupes interdits en Russie, participent aux manifestations.
Tatyana Ladaïeva : Pouvez-vous préciser ce que ces manifestants veulent obtenir ? Veulent-ils que Trump démissionne complètement, qu'il renonce à ses pouvoirs ? Ou s'agit-il peut-être d'une procédure de destitution ? Ou bien exigent-ils simplement que Trump modifie sa politique sur certaines questions clés ?
Alexandre Douguine : Je pense qu'ils sont incapables de réfléchir de manière sensée. Le fait est que sous le règne des démocrates, lorsque les écoles imposaient le changement de sexe, au moment où une personne était capable de participer à des manifestations, sa capacité de réflexion critique était déjà compromise. Une grande partie de la société américaine est dans un état d'hallucination, favorisé par la propagation des drogues et un phénomène connu sous le nom de « brain rot » (pourrissement cérébral), une culture de mèmes absurdes qui captive des millions d'utilisateurs. Plus le contenu est stupide, plus il devient populaire. Ce « brain rot » est l'état dans lequel se trouve une grande partie des Américains. Il est très facile de diriger cette masse, qui ne travaille nulle part, vit des allocations sociales et des drogues, vers des manifestations, même sans expliquer les objectifs. Il s'est avéré que George Soros finance les participants en leur distribuant de l'argent et des biscuits, comme dans les révolutions colorées classiques.

C'est un coup dur pour Trump: il a gagné, alors qu'il aurait dû perdre; il a proclamé les valeurs traditionnelles, ce qui est inacceptable pour ses adversaires. Maintenant, on tente de le renverser, de le discréditer, en montant tout le monde contre lui, des transgenres aux Latino-Américains. Mais cette masse en décomposition n'a pas de plan constructif, comme dans les autres révolutions colorées. Les démocrates et les mondialistes semblent pousser délibérément les États-Unis vers une guerre civile ou un conflit nucléaire, sans proposer aucune vision positive de l'avenir. L'agression, la violence, la dégénérescence, le sadisme, la perversion sont omniprésents, mais il n'y a pas d'image de l'avenir. Nous avons précipité les choses en discutant de la suppression du terme « escalade » : celle-ci ne fait que s'intensifier, et dans ce chaos naissent les scénarios les plus fous. La Russie doit rester un bastion de bon sens et continuer à avancer vers ses objectifs, mais c'est difficile, car nous faisons partie de ce monde et le « brain rot » nous touche aussi.
16:13 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, iran, israël, état-unis, donald trump, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 juin 2025
La politique étrangère des États-Unis est-elle hors du contrôle de Trump ?

La politique étrangère des États-Unis est-elle hors du contrôle de Trump ?
par Davide Malacaria
Source: https://www.piccolenote.it/mondo/la-politica-estera-usa-e...
« Voici la réalité de ce qui est en jeu, de ce que nous affrontons aujourd’hui, car pendant que nous sommes ici, plus que jamais, nous sommes tout proches de l’annihilation nucléaire, tandis que les guerres de l’élite politique alimentent imprudemment la peur et la tension entre les puissances nucléaires. » C’est ainsi que Tulsi Gabbard s’est exprimée dans une vidéo inhabituelle, publiée sur YouTube après sa visite à Hiroshima, où elle appelle les peuples à faire entendre leur voix pour arrêter cette dérive.

Gabbard sait de quoi elle parle, puisqu’elle dirige le renseignement national américain et a accès aux informations les plus confidentielles des agences fédérales. Ce n’est pas une plaisanterie de mauvais goût, mais la réalité dramatique, qui s’est encore accentuée après l’attaque contre les bombardiers stratégiques russes la semaine dernière.
Cette attaque cache des arrière-plans inquiétants, au-delà des motifs évoqués que j'ai évoqués dans une note précédente, à savoir faire échouer le processus de paix d’Istanbul prévu pour le lendemain, et déclencher une réaction russe pour amorcer un conflit direct avec l’Occident.
Alastair Crooke en parle dans un article publié sur le site du Ron Paul Institute, où il décrit ces arrière-plans. La première, qui découle du fait que les Ukrainiens ne pouvaient pas mener une opération aussi sophistiquée en solitaire, est que c’est l’Amérique qui a coordonné l’opération, évidemment en collaboration avec la Grande-Bretagne (Londres dirige également l’Union européenne, en tirant les ficelles des marionnettes placées au sommet de l’UE et de l’Allemagne).
Le Silence des Ours
Ce contrôle extérieur de l’attaque est évident, mais Crooke explique que peut-être Trump a donné son feu vert en croyant à ce que lui ont rapporté ses conseillers, selon lesquels la Russie était proche de l’effondrement, et qu’en augmentant la pression — par des attaques stratégiques visant à dégrader le moral russe — Moscou serait contrainte de céder.
Dans ce cas, Trump aurait été victime du manque de réalisme de ses conseillers, perdus dans leurs rêveries et incapables de comprendre la véritable force économique et militaire de la Russie. Crooke ne le précise pas explicitement, mais en citant un tweet de Trump — « Des choses terribles, si ce n’était pas moi, des choses VRAIMENT TERRIBLES arriveraient à la Russie » — il est clair que, si cette approbation existait, elle aurait été limitée.
La seconde hypothèse plus crédible, selon Crooke, est que « peut-être ses conseillers, involontairement ou délibérément, ont ‘trompé’ Trump et son programme de normalisation des relations avec la Russie ». L’initiative d’attaquer les bombardiers russes aurait été prise à l’insu du président, et justifiée par la suite sous le prétexte que « la CIA a simplement agi en fonction d’une vieille directive présidentielle autorisant des attaques en profondeur à l’intérieur du territoire russe. »

Au-delà de nos considérations, selon Crooke, dans les deux cas, ce qui s’est passé signifie « une seule chose : que Trump n’a pas le contrôle. » Il l’éclaire davantage en expliquant qu’un objectif stratégique de l’attaque — qui a réussi et a prouvé qu’elle était « réalisable » — est que cela a « imposé à Trump la dure réalité de ne pas avoir le contrôle de la politique étrangère des États-Unis […]. Le Deep State collectif lui a fait comprendre cela. »
À ce propos, il cite le général Michael Flynn, qui explique : « L’État profond agit désormais en dehors du contrôle de la direction élue de notre nation… les hommes de l’État profond s’efforcent de provoquer la Russie pour ouvrir un affrontement à grande échelle avec l’Occident. »
L’alerte lancée par Gabbard, sous une forme si inhabituelle, semble confirmer les difficultés de Trump, qui aurait pu lui demander de prendre cette initiative surprenante.
Crooke explique aussi que l’attaque contre la Russie a exploité une vulnérabilité du Traité Salt-Start sur les armes nucléaires, en particulier l’article XII du traité START qui exige que les puissances signataires « exposent visiblement » tous les bombardiers lourds à l’intérieur de leur base aérienne. Ceci afin qu’ils puissent être surveillés par des satellites ennemis pour empêcher tout “premier coup” d’une des parties.
L’attaque contre les bombardiers russes fragilise donc un des piliers de l’accord sur la dissuasion nucléaire mutuelle, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Selon Crooke, la Russie préparerait une réaction différente de celles qu’elle a déjà menées, qui s’est traduite par une intensification des attaques conventionnelles en Ukraine, mais cela pourrait ne pas être le cas.
Il est évident que Trump, lors de l’appel apaisant avec Poutine, lui aurait demandé d’être patient, de répondre de manière mesurée pour ne pas le mettre entre les mains de ses ennemis (des ennemis extérieurs pour le tsar, des ennemis intérieurs pour le président américain).
Et, en même temps, il lui aurait assuré qu’il ferait tout pour éviter de telles initiatives. Il est probable que Poutine ait accepté, conscient des marges de manœuvre limitées de son interlocuteur et de la nécessité de ne pas le livrer aux ennemis communs.
Mais Trump doit agir rapidement pour changer les choses s’il veut prendre le contrôle d’un système géré par d’autres. Un petit, mais non négligeable, signal vient du nouveau programme de financement de la Défense élaboré par le Secrétaire de ce ministère, Pete Hegseth, l’un des rares hommes fidèles à Trump dans son administration (lui aussi a dû lutter pour être confirmé par le Congrès, tout comme Tulsi Gabbard).
Ce plan, développé par Hegseth, fait l’objet d’un article dans Responsible Statecraft, dont le titre est évocateur : « Le Secrétaire à la Défense déclare la guerre au complexe militaro-industriel. » En expliquant les coupes dans la défense, Hegseth a déclaré que certaines grandes industries de l’armement pourraient faire faillite en un ou deux ans. Le texte prévoit également une réduction de l’aide directe à Kiev…
Lobbying : la guerre contre le complexe militaro-industriel
En réalité, il ne s’agit pas d’un affrontement direct avec une des composantes du Deep State, et il ne semble pas, du moins pour le moment, que l’Ukraine reste totalement sans aide made in USA, mais cela signale une inversion de tendance qui inquiète beaucoup ces cercles, car ils ne supportent aucune limitation.
Il reste que le texte doit être approuvé par le Congrès, où de nombreux membres ont plus ou moins ouvertement des liens avec l’industrie militaire. L’approbation sera très difficile, et il est probable que le plan subisse des modifications pour le rendre moins désagréable, voire même plus acceptable pour ceux qui profitent des guerres faites par les États-Unis ( déclarées ou non).
11:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, états-unis, deep state, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 juin 2025
Donald Trump a échoué

Donald Trump a échoué
Par Franz Ferdinand
Source: https://www.unser-mitteleuropa.com/169698
Donald Trump s'est présenté en annonçant qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine et ne déclencherait pas d'autre guerre. Il a échoué sur ces deux points. Il est évident qu'il n'a pas pu s'imposer face à « l'État profond » et au « lobby israélien » :
- 1. Guerre en Ukraine :
L'attaque partiellement réussie de l'Ukraine contre la flotte de bombardiers stratégiques russes le 2 juin 2025, planifiée et menée avec l'aide des États-Unis pendant 18 mois, a détruit la confiance entre Poutine et Trump. Il convient notamment de souligner que, conformément au traité START II, ces avions doivent être visibles par satellite et ne peuvent être cachés dans des hangars. Ces coordonnées ont été transmises aux Ukrainiens, ce qui a montré que Trump et les États-Unis étaient partiaux dans cette guerre et inaptes à jouer le rôle de médiateurs.
- 2. Attaque d'Israël contre l'Iran :
Cette attaque a également été planifiée pendant un an et menée avec l'aide des États-Unis et de leurs alliés dans cette région (Arabie saoudite, Irak, Oman, etc.). Une opposition interne coopérant avec Israël a certainement participé à cette attaque. Sinon, il aurait été impossible de connaître les lieux de séjour des personnes assassinées.
Le renversement du régime syrien, au cours duquel Assad a été remplacé par une bande de coupeurs de têtes pro-occidentaux, faisait manifestement partie de ces préparatifs, avec le recul.
Il est particulièrement piquant de noter que le négociateur en chef iranien pour les négociations entre l'AIEA et l'Iran (Amirhossein Faghihi) a été assassiné. Ces négociations auraient dû avoir lieu le 15 juin 2025 et ont manifestement été empêchées de manière délibérée.

Cette attaque est clairement contraire au droit international, car la menace que représente l'Iran pour Israël a été tout autant fantasmée que l'étaient autrefois les armes de destruction massive irakiennes, qui ont servi de prétexte à la deuxième guerre en Irak. L'affirmation selon laquelle l'Iran posséderait déjà de l'uranium de qualité militaire ou serait sur le point d'enrichir de l'uranium à ce niveau est un mensonge éhonté.
Lors de l'attaque des bombardiers israéliens, des informations provenant de l'AIEA ont apparemment été utilisées, ce qui montre clairement que cette organisation n'est pas neutre.
Ce qui est vraiment en jeu dans ce conflit :
Le conflit entre Israël et l'Iran est une guerre par procuration, tout comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'ingérence des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Iran remonte à 1953, lorsque le premier ministre démocratiquement élu, Mossadegh, a été renversé par la CIA. Après le renversement du Shah, qui a ensuite été exilé, la République iranienne et les États-Unis sont entrés dans un conflit permanent. Israël n'a ici qu'un rôle de chien de garde.
Tout ce débat autour du programme nucléaire iranien n'est qu'un écran de fumée. En réalité, il s'agit de maintenir l'ordre mondial unipolaire.
Le contrôle de l'Occident sur l'Iran pourrait bloquer le développement économique de l'Asie et ainsi défendre l'ordre mondial unipolaire. À l'inverse, l'Iran, en tant que plaque tournante du transport, joue un rôle clé dans le développement d'un ordre mondial multipolaire :
- En 2021, la Chine a conclu un partenariat stratégique avec l'Iran, qui permet à ce dernier de contourner les sanctions occidentales. La Chine obtient du pétrole bon marché et investit des milliards en Perse (La Chine conclut un pacte à long terme avec l'Iran – DiePresse.com: https://www.diepresse.com/5958091/china-schliesst-langfristigen-pakt-mit-dem-iran ). Le transport du pétrole iranien bon marché s'effectue par chemin de fer. La «nouvelle route de la soie» promue par la Chine traverse également la Perse.
- Une deuxième ligne de transport importante est le corridor nord-sud (corridor nord-sud, commerce : le coup géopolitique de Poutine: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/520992/putins-schachzug-geostrategisch-bedeutende-handelsroute-in-betrieb-genommen), qui est en service depuis 2022. Il est destiné à transporter des marchandises de la Russie à l'Inde en passant par l'Iran. Ce corridor, cauchemar des puissances maritimes et concurrent du canal de Suez, permet également à la Russie de contourner les sanctions économiques.
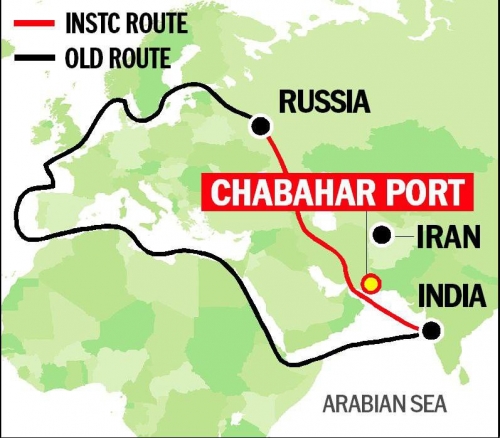
Comme on peut le constater, la Perse est une plaque tournante pour le trafic nord-sud et est-ouest, contournant les routes maritimes. Les puissances maritimes occidentales perdent automatiquement leur importance. L'ordre mondial unipolaire avec ses « règles » imposées par les élites occidentales perd alors tout son sens.
L'objectif de l'attaque israélienne est donc un renversement politique en Iran afin d'entraver le développement économique de l'Asie.
L'attaque d'Israël contre l'Iran est donc encore plus dangereuse que la guerre par procuration menée par l'Ukraine contre la Russie, car elle affecte les intérêts de toute l'Asie. On peut donc supposer que les pays du BRICS, à savoir la Russie, la Chine et l'Inde, n'accepteront pas sans réagir un renversement du régime iranien orchestré par l'Occident. Toute la démarche de l'Occident rappelle le coup d'État de Maïdan. Il semble que l'on veuille porter au pouvoir un petit groupe d'opposants. Un tel coup d'État ne fonctionnera probablement pas une deuxième fois.
On peut également considérer toute l'action d'Israël comme faisant partie de la guerre contre la Chine, sans cesse fantasmée. Israël et les États-Unis risquent ainsi que la Chine s'écarte de sa politique jusqu'ici réservée et soutienne directement l'Iran.
Outre le soutien militaire à l'Iran, la Chine dispose toutefois d'autres options:
En réaction aux droits de douane punitifs imposés par Trump, la Chine a décrété un embargo sur les exportations d'aimants et de terres rares. La Chine produit environ quatre fois plus de terres rares que les États-Unis (Terres rares » Utilisation, gisements et investissement: https://finanzwissen.de/rohstoffe/kritische-metalle/seltene-erden/). La Chine met ainsi en péril la production dans le secteur de l'électronique et, par conséquent, la production d'armements, de voitures électriques et bien d'autres choses encore (La Chine suspend ses exportations de terres rares | Telepolis: https://www.telepolis.de/features/China-stoppt-Export-Seltener-Erden-10352326.html#:~:text=Eine%20Fabrik%20zur%20Verarbeitung%20seltener%20Erden%20in%20Chinas,allem%20US-Schl%C3%BCsselindustrien%20von%20Elektroautos%20bis%20Milit%C3%A4rtechnik.%20Ein%20%C3%9Cberblick).
La victoire d'Israël lors de son attaque contre l'Iran peut donc être comparée à la victoire de l'Allemagne hitlérienne sur la Pologne, qui n'a fait que créer de nouveaux ennemis à Hitler. Il pourrait en être de même pour Israël. Israël a remporté une victoire à la Pyrrhus, qui porte déjà en elle les germes de la défaite.
À l'origine, avec sa politique « America first », Trump poursuivait l'idée d'abandonner la prétention unipolaire de l'Amérique et d'accepter un monde multipolaire. Cela aurait été la solution au problème le plus urgent de l'Amérique, à savoir la question de la dette. Les dépenses pour des guerres inutiles auraient été supprimées et de nouvelles opportunités commerciales, par exemple avec la Russie, auraient été possibles pour augmenter les recettes. Mais tout cela est désormais terminé. Les États-Unis sont toujours sur la voie de la ruine. Les besoins annuels de refinancement des États-Unis s'élèvent actuellement à 10.000 milliards de dollars. Les investisseurs étrangers ne sont plus disposés à les financer. En fin de compte, la FED doit intervenir et simplement imprimer de l'argent pour sauver le budget. Cela creuse encore davantage la tombe du dollar américain et accélère la dédollarisation de l'économie mondiale. La hausse actuelle du cours de l'or confirme cette tendance.
Le sauvetage des États-Unis par la voie démocratique a donc échoué. Le « Deep State » ne peut être destitué et continuera à entraîner les États-Unis vers leur perte.
14:14 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, donald trump, états-unis, ukraine, chine, iran, asie, israël |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 juin 2025
Trump, Musk et le conflit interne au capitalisme américain

Trump, Musk et le conflit interne au capitalisme américain
par Alessandro Volpi (*)
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/30662-ales...
Le conflit entre Donald Trump et Elon Musk, entre le président des États-Unis et l'homme le plus riche du monde, qui a été son principal bailleur de fonds pendant la campagne électorale, a commencé discrètement et a explosé de manière retentissante, quand ils se sont lancé les pires accusations. Musk est allé jusqu'à mettre en cause l'implication de Trump dans la très controversée « affaire Epstein » et à envisager la création d'un nouveau parti pour battre le président actuel. Les raisons de cette explosion sont multiples et difficiles à résumer. Je vais essayer d'en énumérer quelques-unes.
La première, à mon avis très importante, est le signal que Trump a voulu envoyer aux Big Three, BlackRock, Vanguard et State Street, et plus généralement à ce type de finance, qui n'est certainement pas en bons termes avec Musk. Ces trois fonds ont été, et sont toujours, de grands actionnaires de Tesla, mais ils ont toujours manifesté une certaine hostilité envers Musk, qu'ils voulaient remplacer à la tête de Tesla, malgré ses 13% de parts, dès 2018, et à qui ils ont reproché la mauvaise opération d'achat de Twitter, cause d'importantes pertes de valeur pour la société.
Ces mêmes grands fonds n'ont certainement pas apprécié le positionnement ferme de Musk en faveur de Trump et, paradoxalement, après l'élection de Trump, lorsque les actions Tesla ont grimpé en flèche, atteignant une capitalisation de mille milliards de dollars, ils ont commencé à réduire leur participation dans la société.
En effet, aux yeux de BlackRock et consorts, Trump représentait un grand danger d'instabilité pour les cours boursiers, comme le montraient les données des premiers mois suivant son investiture, et contre lequel il fallait lutter, en frappant bien sûr aussi son principal soutien. De plus, l'instabilité générée par Trump et la surévaluation atteinte par Tesla dans le sillage de son lien avec le président des États-Unis ont effrayé certains grands clients de BlackRock, comme le fonds des enseignants américains, qui ont demandé à Larry Fink de faire preuve d'une plus grande prudence dans l'exposition à ce titre.
Ainsi, au cœur du conflit entre la haute finance des grands gestionnaires et des grandes banques, à commencer par Jp Morgan de Jamie Dimon, et Trump, qui a culminé avec la partie cruciale que fut l'achat des titres de la dette fédérale américaine, qui est de plus en plus précaire, dont les fonds eux-mêmes ont menacé de vente éventuelle, avec des effets dévastateurs sur le coût des intérêts, la figure de Musk est devenue de plus en plus encombrante.
Pour être encore plus clair, dans le conflit interne au capitalisme financier américain, les Big Three ont compris qu'ils pouvaient demander la tête de Musk à un Trump également attaqué par la Réserve fédérale.
À cet égard, un deuxième élément, partiellement lié au premier, a toutefois pesé dans la balance. Le renvoi de Musk, après sa démission du Doge, signifie son redimensionnement drastique dans le domaine fondamental de l'intelligence artificielle, où d'autres personnalités proches de Trump, avec lesquelles Musk a vu ses relations se détériorer, font pression pour jouer un rôle crucial. Il s'agit, entre autres, de Peter Thiel et Larry Ellision, qui aspirent à jouer un rôle décisif dans la perspective d'un financement fédéral important dans ce secteur.
L'hostilité de Thiel envers Musk s'inscrit également - et c'est là un troisième facteur - dans l'aversion que la droite américaine, résolument pro-Trump, a toujours nourrie envers le Sud-Africain ; une droite radicale, dirigée par Steve Bannon, qui a toujours condamné la nature « techno-féodale » du capitalisme de Musk et ses origines « immigrées ».
Ces réserves sévères à l'égard du milliardaire s'expliquent également par les attaques des ministres clés de l'administration Trump, à commencer par Bessent et Lutnick, et des dirigeants des départements fédéraux très influents, touchés par l'action brutale du Doge, à commencer par celui de la Défense, certainement hostile à l'idée de Musk d'accélérer le processus, déjà en cours depuis un certain temps, de sa privatisation. Enfin, il faut tenir compte des traits de caractère de Trump, qui n'a pas apprécié les déclarations excessives de Musk, ses critiques souvent peu modérées à l'égard de diverses lois émises par le Président, en particulier celle du Big Beautiful Bill.

Trump ne veut en aucun cas être considéré comme le chef d'une équipe et a bâti sa fortune électorale sur sa capacité à se présenter comme le seul et unique interprète de l'« esprit américain », sans aucune médiation.
En ce sens, l'adhésion à la vision Maga a, pour Trump, des traits fidéistes, les seuls capables de rendre moins évident le détachement de la réalité en cas d'échec. Musk était trop envahissant, même dans le rôle du grand prêtre du culte trumpien, et, de plus, la solidité de sa relation avec Trump aurait compromis l'autre grand élément de la stratégie trumpienne, à savoir l'imprévisibilité absolue: ce n'est que grâce à la possibilité de tout changer à tout moment que l'ancien magnat pense pouvoir être interprété comme le faiseur du destin collectif, politique et surtout financier.
Une dernière considération concerne l'avenir de Musk, très incertain en raison de sa forte dépendance à la présidence Trump. Avec la victoire de Trump, Tesla a explosé et est maintenant en chute libre, tout en conservant des indicateurs largement surévalués, comme un ratio cours/bénéfices de 161, qui devront tenir compte de la fin des subventions annoncée dans le déjà mentionné le texte de la Big Beautiful Bill, qui n'est pas sans raison critiquée par Musk, et de l'agressivité des agences de notation. L'homme le plus riche du monde risque sérieusement de s'effondrer rapidement, ce qui témoigne également de la crise abyssale du capitalisme.
(*) Post Facebook du 6 juin 2025
12:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, elon musk, état-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 juin 2025
Les conséquences de la rupture «pacifique» entre Trump et Musk

Les conséquences de la rupture «pacifique» entre Trump et Musk
par Alessandro Volpi (*)
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/30615-ales...
La rupture « pacifique » entre Trump et Musk, qui a conduit à la démission du créateur de Starlink, constitue un élément très important du paysage politique et économique américain.
Du point de vue de Musk, son exposition politique le place dans une situation de tension constante; il a été lâché par les grands fonds, qui sont en conflit ouvert avec Trump et qui ont vendu des actions Tesla, tandis que ses nombreuses affaires avec l'administration américaine l'exposent à de vives critiques pour des conflits d'intérêts sur lesquels les tribunaux américains, de plus en plus hostiles à Trump, peuvent le coincer. À cela s'ajoute l'hostilité des ministres de Trump envers le Sud-Africain et la méfiance croissante de personnalités telles que Peter Thiel, notamment en ce qui concerne la grande bataille pour les fonds fédéraux dans le domaine de l'intelligence artificielle.
À la lumière de tout cela, Musk, qui a été contourné par une partie de l'appareil d'État et a jugé le Big Beautiful Bill trop conciliant, a pensé que se retirer, tout en conservant une relation informelle mais étroite avec Trump, était le meilleur moyen de subir moins de pressions et de retrouver visibilité et autonomie, en cohérence avec l'image qu'il s'est construite, celle d'un génie indiscipliné, même par rapport au président le plus atypique des États-Unis. Pour Trump, la rupture avec Musk s'inscrit dans une stratégie d'imprévisibilité qui apparaît de plus en plus évidente. Ses changements de position constants et son caractère insaisissable sont des outils qui lui permettent de ne donner aucun repère identifiable à sa personne.
Grâce à cette stratégie, il peut déterminer l'évolution des cours à sa guise, réussissant à les influencer plus que tout autre acteur public ou privé, même plus que les Big Three, et favorisant le transfert des économies vers l'immensité des « marchés parallèles » et vers la création et le financement de multiples stable coins, utilisées pour couvrir la dette publique américaine.
Il est clair qu'une telle stratégie est extrêmement dangereuse et Trump tente de la modérer en recourant, une fois de plus, à des choix tout à fait personnels et autoréférentiels: des négociations avec la Chine et la Russie, qui se traduisent par des contacts directs avec les dirigeants, au choix des « favoris » en termes économiques et financiers, démontrant précisément avec l'affaire Musk que personne ne bénéficie de garanties, jusqu'aux relations avec le Congrès.
Mais le vrai problème est ailleurs: ce système de pouvoir ne peut tenir que si Trump parvient réellement à incarner directement « l'esprit » du peuple américain, ou du moins d'une partie de celui-ci, prêt à le suivre jusqu'au bout. Trump n'aspire pas à être un chef politique ni même le point de référence des intérêts des puissants, mais à jouer le rôle du grand prêtre d'une religion pour laquelle la foi compte plus que toute dimension réelle. Ceux qui l'ont choisi ne doivent pas essayer de le comprendre, mais doivent se fier à sa capacité divinatoire, posée comme « supérieure »: une religion qui s'enracine certainement dans un contexte social et culturel où trente ans de mondialisation ont généré une fragmentation tragique et un isolement brutal des individus, désormais prêts à croire au salut apporté par une appartenance de type fidéiste.
Le capitalisme financier a produit le capitalisme religieux, toujours et exclusivement au nom de l'argent.
(*) Post Facebook du 31 mai 2025.
20:09 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donald trump, elon musk, étaits-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
« Poutine veut toute l'Ukraine »: Douguine décortique la déclaration de Trump

« Poutine veut toute l'Ukraine »: Douguine décortique la déclaration de Trump
Alexandre Douguine
Ce que Trump a écrit dans son message et qui n'a pas été souvent cité chez nous, en Russie, contenait des mots importants : "Poutine veut toute l'Ukraine".
Mais il faut comprendre qu'il veut libérer toute l'Ukraine du régime naziste qui s'y est installé avec la complicité de l'Occident "anti-fasciste". C'est dans ce sens qu'il veut toute l'Ukraine. Pour qu'il ne reste aucune trace, aucune chance pour le groupe néonaziste, terroriste et extrémiste qui a illégalement pris le pouvoir sur le territoire de cette partie historique de notre espace culturel, géopolitique et politique unique. C'est donc notre affaire interne.
Trump souhaite sincèrement mettre fin à la guerre et, à mon avis, il n'y a là aucune fourberie ni mensonge. Mais il ne sait pas de quelle guerre il s'agit. Au début, il l'appelait « la guerre de Biden », maintenant il dit que c'est « la guerre de Biden, Zelensky et Poutine ». Mais surtout, il comprend que ce n'est pas sa guerre. Cependant, il y participe. De plus, divers cercles mondialistes et néoconservateurs le poussent à continuer de participer à cette guerre « qui n'est pas la sienne » et qui ne lui apportera rien d'autre que des problèmes.
C'est pourquoi il souhaite sincèrement mettre fin à cette guerre, mais ne sait pas comment s'y prendre. Et lorsqu'il se plonge dans l'analyse de ce problème, en essayant de comprendre qui se bat contre qui, pourquoi, quels sont les plans de chacun – au-delà de la propagande –, il découvre une image qui ne ressemble en rien aux sentiments et aux formes sous lesquels ce conflit lui est présenté en Occident. Il comprend que l'affaire est très sérieuse et qu'il existe effectivement des « lignes rouges » que nous, les Russes, ne franchirons jamais. L'Ukraine doit être libérée du régime naziste, elle doit devenir différente. Et tant qu'elle ne sera pas fondamentalement différente, la guerre ne prendra pas fin.
Mais Trump souhaite mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et subit une pression énorme de toutes parts. En premier lieu, de la part des personnes qui le détestent. Macron, Starmer, les dirigeants canadiens (le nouveau Premier ministre élu Carney est aussi libéral que Trudeau), Merz, le Parti démocrate américain, tous les mondialistes, le « deep state » veulent que Trump participe à cette guerre, qu'il s'engage dans une escalade avec la Russie. Et ainsi les aider à porter un coup à leurs principaux adversaires: c'est-à-dire à Poutine et... à Trump lui-même.
Bien sûr, Trump ne peut pas ne pas comprendre cela. Mais il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Il veut arrêter une guerre qu'il est actuellement impossible d'arrêter. Mais il n'est pas encore prêt à accepter nos conditions, car il n'est tout simplement pas encore « mûr », il n'a pas encore «compris». Et comme il est attaqué de toutes parts sur d'autres questions — les tarifs douaniers, la politique intérieure, le blocage de toutes ses décisions par la coterie des juges, qui s'est avérée être simplement le réseau de Soros — et qu'il voit qu'il ne réussit en rien sur aucun de ces fronts, il s'en prend à nous.
Au final, personne dans notre direction n'a particulièrement insisté sur cette déclaration désagréable, dure et peu diplomatique de Trump à l'égard de la Russie, la considérant comme une simple crise de nerfs. Oui, à première vue, il s'agissait bien d'une crise de nerfs. Mais en même temps, il comprend parfaitement que nous avons besoin de toute l'Ukraine, mais il n'est absolument pas prêt à nous céder toute l'Ukraine. Voilà le problème.
Mais le temps guérit tout. Je pense que le sommet prévu entre Trump et Poutine guérira beaucoup de choses. Et dans cette conversation privée, la question de l'Ukraine pourrait même passer d'une position centrale à une position périphérique. Nous avons des choses bien plus importantes à régler et des problématiques communes à résoudre. La Russie, les États-Unis et la Chine, trois États-civilisations, doivent répartir de manière définie leurs zones d'influence dans le nouveau monde multipolaire. C'est de cela, me semble-t-il, que Trump et Poutine doivent discuter. L'Ukraine n'est pas un sujet qui doit être sérieusement abordé à un tel niveau.
Je ne prêterais donc tout simplement pas attention à ces déclarations virulentes, comme le fait très judicieusement, sagement et efficacement notre président. Ne faisons pas tout un scandale à cause des propos lourdauds de Trump. Nous sommes une grande puissance qui connaît sa valeur, et les autres la connaîtront aussi.
Nous devons maintenant nous préparer à mener cet été une campagne militaire convaincante et efficace, en libérant autant de terres russes ancestrales que possible, tout en empêchant l'ennemi d'envahir notre territoire. Et si nous y parvenons, Trump commencera progressivement à nous traiter différemment. Mais pour commencer, nous avons besoin d'une victoire militaire: éclatante, réussie, puissante, à grande échelle. Et alors, le discours changera.
Quant aux menaces de Trump, nous avons déjà entendu cela à maintes reprises. De la part de Biden, de l'Union européenne. En fait, il veut dire qu'en cas de problème, la Russie pourrait subir une frappe nucléaire de la part des États-Unis. Mais l'Amérique peut aussi subir une frappe nucléaire de la part de la Russie. C'est donc un mauvais discours, et je ne voudrais pas que ces menaces continuent à être proférées. Ce n'est pas là un discours sérieux. Trump n'est pas là pour simplement suivre le pire scénario de la politique mondialiste de Biden, dictée par le « deep state ». Je pense qu'il faut clore ce sujet et ne pas y répondre.
Mais si vous voulez vraiment une escalade, eh bien, nous sommes prêts à tout, y compris à une escalade. Mais mieux vaut garder le silence.
19:34 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, ukraine, russie, alexandre douguine, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Trump au Moyen-Orient

Trump au Moyen-Orient
Abbès Tégrarine
La visite du président Donald Trump en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis du 13 au 16 mai a été sa première visite officielle depuis son investiture le 20 janvier 2025. Cette visite revêt sans aucun doute une importance particulière à plusieurs égards. Les médias arabes le qualifient d'historique, car il a précédé la visite du président américain chez les alliés traditionnels de son pays en Europe, chez ses voisins les plus proches ou chez son allié stratégique au Moyen-Orient, Israël. La première de ces conséquences concerne « l'importance économique et stratégique de ces pays pour les États-Unis », comme l'a souligné le représentant spécial adjoint des États-Unis au Moyen-Orient.
De plus, il ne faut pas négliger l'influence considérable des pays du Golfe Persique sur le marché mondial de l'énergie, sans oublier, bien sûr, les impératifs économiques urgents des États-Unis au niveau national et les événements géopolitiques mondiaux. Les États-Unis ont également commencé à compter sur le rôle croissant des trois États du Golfe Persique sur la scène internationale.
Bien que la tournée de Trump dans les pays du Golfe ait porté sur plusieurs questions économiques, politiques et stratégiques importantes pour les deux parties, les plus importantes étant le partenariat économique entre les pays du Golfe et les États-Unis, la politique énergétique, les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, les accords de défense et les garanties de sécurité, la guerre à Gaza, le dossier syrien, les accords d'Abraham, la guerre en Ukraine, etc. Ces questions ont également été abordées lors du cinquième sommet entre les États-Unis et le Conseil de coopération du Golfe, qui s'est tenu le 14 mai à Riyad. Cela a donné un élan puissant au partenariat stratégique entre les deux parties :
L'importance du contexte économique international de la visite de Trump dans le Golfe Persique
Plusieurs facteurs façonnent le contexte international et déterminent la réalité économique mondiale qui coïncide avec la visite du président Trump dans la région du Golfe Persique, ce qui rend cette visite extrêmement importante. Le protectionnisme, qui a atteint des niveaux records, entraîne un affaiblissement correspondant des règles de la mondialisation et a des conséquences particulières sur la crise de la dette souveraine et le maintien des pressions inflationnistes dans le monde.
Les médias arabes ont concentré leur attention sur les accords économiques majeurs annoncés entre les pays du Golfe Persique et les États-Unis.

Les accords saoudo-américains les plus importants :
Dans le cadre des plans plus larges d'investissement de l'Arabie saoudite à hauteur de 600 milliards de dollars dans la production, les produits et les services américains, annoncés en janvier 2025, les accords économiques les plus importants signés lors de la visite de Trump en Arabie saoudite, outre les accords militaires que nous présentons ci-dessous, sont les suivants :
- Nvidia a conclu un accord pour la fourniture de ses puces IA.
- AMD a conclu un partenariat similaire d'une valeur de 10 milliards de dollars avec une société saoudienne, et Amazon s'est engagé dans la « Zone d'intelligence artificielle » avec un plan d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars.
- Google soutient un nouveau fonds d'intelligence artificielle de 100 millions de dollars, ainsi qu'un accord de 20 milliards de dollars avec la société américaine Supermicro.

Les accords qataro-américains les plus importants :
Après que le Qatar a annoncé un engagement d'investissement de 1200 milliards de dollars, des accords d'une valeur totale de plus de 243,5 milliards de dollars ont été conclus lors de la visite de Trump au Qatar, à savoir:
- Qatar Airways a signé un accord de 96 milliards de dollars pour l'achat de 210 avions auprès de Boeing, ce qui représente la plus grande commande d'avions à fuselage large de l'histoire et la plus grande commande de 787 de l'histoire.
- L'Autorité de gestion des investissements du Qatar prévoit d'investir 500 milliards de dollars supplémentaires au cours de la prochaine décennie dans les secteurs de l'intelligence artificielle, des centres de données et de la santé aux États-Unis, conformément à son programme de relance aux États-Unis.
Accords entre les Émirats arabes unis et les États-Unis :
La société Emirates Global Aluminium, basée en Oklahoma, réalise un projet de construction d'une usine de production d'aluminium primaire d'une valeur de 4 milliards de dollars, en plus des investissements de la société et du Conseil économique des Émirats arabes unis Tawazun dans un projet de production de gallium afin de soutenir l'approvisionnement en métaux essentiels aux États-Unis.
Dans le domaine des technologies, la société américaine Qualcomm a annoncé son intention de contribuer au développement d'un nouveau « centre d'ingénierie mondial » à Abu Dhabi, axé sur l'intelligence artificielle et les centres de données.
Conséquences politiques et stratégiques de la visite de Trump dans le golfe Persique
Négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran :
Les médias ont souvent rapporté que les États-Unis avaient présenté à l'Iran une proposition de nouvel accord nucléaire lors du quatrième cycle de négociations à Mascate (11 mai 2025).
À Doha (le 15 mai), le président Trump a annoncé que l'Iran avait globalement accepté les conditions de la proposition américaine et a annoncé la conclusion prochaine d'un accord.

La guerre à Gaza :
Bien que le président Trump n'ait pas soulevé la question du déplacement des habitants de Gaza, auquel les États du CCG s'opposent fermement, ni celle de la création d'une administration américaine « temporaire » ou « transitoire » pour Gaza après la guerre lors du sommet entre les pays du Golfe et les États-Unis, il a réaffirmé, lors d'une réunion de travail à Doha le 15 mai, son souhait que les États-Unis « prennent le contrôle » du secteur de Gaza et le transforment en « zone libre ». Auparavant, Trump avait déclaré vouloir transformer Gaza en « Riviera du Moyen-Orient » en expulsant ses habitants. Cette question restera une pomme de discorde entre les États du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCEAG), qui soutiennent le plan arabe de reconstruction du secteur de Gaza sans déplacement de sa population, et les États-Unis.
Le dossier syrien :
La question de la réintégration de la Syrie sous la direction du président Ash-Sharaa dans le système régional et international, initiée par les États du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite, ainsi que la normalisation des relations américano-syriennes figuraient à l'ordre du jour de la visite de Trump à Riyad. La déclaration « très, très importante » que Trump avait promis de faire en Arabie saoudite était probablement liée à la levée des sanctions contre la Syrie et à sa rencontre avec le président syrien, à laquelle ont également participé le prince héritier d'Arabie saoudite et le président turc Recep Tayyip Erdogan (par vidéoconférence). Lors de sa rencontre avec Ash-Sharaa, Trump a promis de normaliser les relations de son pays avec la Syrie et a discuté avec lui d'un certain nombre de questions, notamment la lutte contre le « terrorisme ». Cela concerne en particulier l'EIIL, la question des combattants étrangers en Syrie (leur départ de Syrie), l'expulsion des membres de la résistance palestinienne et la sécurité des Kurdes. Selon l'agence de presse saoudienne, la déclaration du président Donald Trump sur la levée de toutes les sanctions contre la Syrie a surpris certains membres de son administration.
Guerre en Ukraine :
Lors de sa visite en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, Trump a cherché à utiliser l'efficacité de la diplomatie du golfe Persique pour servir de médiateur dans la fin de la guerre russo-ukrainienne ou, au moins, faire preuve de bonne volonté pour convaincre les parties russe et ukrainienne de cesser le feu et de poursuivre les négociations directes afin de régler le conflit qui les oppose. Cela est particulièrement pertinent compte tenu des tentatives infructueuses des États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu, sans parler de la fin de la guerre. Alors que le temps presse, Trump considère les pays du Golfe Persique, en particulier l'Arabie saoudite, comme un canal utile pour communiquer avec Moscou. L'Arabie saoudite a déjà mené des négociations secrètes entre les États-Unis et la Russie, renforçant ainsi sa position de médiateur neutre.
Influence chinoise :
Dans le cadre de la visite de Trump dans la région, les Américains ont cherché à faire pression sur les États du Golfe Persique, non seulement sur les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite, mais aussi sur les six États du Conseil de coopération des États arabes du Golfe Persique, afin qu'ils prennent leurs distances avec Pékin.
17:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, états-unis, arabie saoudite, qatar, émirats arabes unis, moyen-orient, politique internationale, monde arabe, monde arabo-musulman |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 mai 2025
Les néoconservateurs sont l'outil des mondialistes pour contrôler partiellement Trump

Les néoconservateurs sont l'outil des mondialistes pour contrôler partiellement Trump
Alexander Douguine
L'UE est un bastion des mondialistes, ceux qui ont déclenché la guerre en Ukraine pour infliger une défaite stratégique à la Russie. Ils sont les ennemis jurés du mouvement MAGA et de Trump. Ils forment une structure unifiée avec le Parti démocrate américain, qui fait partie de l'État profond international.
L'élite libérale de l'UE et des États-Unis se prend pour un gouvernement mondial. Leur objectif actuel est de forcer les États-Unis à continuer de combattre la Russie afin de nuire à la fois à Poutine et à Trump. Zelensky et son organisation terroriste internationale sont l'avant-garde de ce gouvernement mondial.
En Europe, l'État profond a établi une dictature directe, bafouant ouvertement ses propres normes démocratiques en ciblant les euro-trumpistes — l'AfD allemande, Marine Le Pen, Georgeascu, Simion — tous ceux à qui il peut nuire. Il n'a pas encore réussi à faire tomber Orbán, Fico, Meloni ou Vučić, mais il essaie.
La conversation entre Poutine et Trump aide Trump à mieux comprendre qui se bat réellement contre qui en Ukraine – et contre qui ailleurs dans le monde. C'est essentiel. Les néoconservateurs américains font partie de l'État profond mondialiste. Au cours du premier mandat de Trump, ils ont bloqué bon nombre de ses initiatives, presque toutes.
L'influence des néoconservateurs est beaucoup plus faible aujourd'hui, mais elle existe toujours, et ils poussent désespérément Trump vers la guerre avec la Russie, tentent d'apporter un réel soutien aux terroristes de Zelensky et visent à établir de nouvelles sanctions. Les néoconservateurs sont l'outil des mondialistes pour contrôler partiellement Trump.
La conversation entre Trump et Poutine est une étape cruciale pour clarifier la situation réelle, pour Trump. Poutine l'a déjà parfaitement compris et aide délicatement Trump à le comprendre également. Cela rend l'État profond furieux. Tel est aujourd'hui le tango des grandes puissances.
Que signifie la paix en Ukraine pour Trump ? Cela signifie que les États-Unis ne participent pas à cette guerre et éliminent la menace d'une escalade nucléaire. Et cela est facile à réaliser. Les États-Unis peuvent déclarer unilatéralement la paix et se retirer. L'escalade prendra fin. Oui, c'est aussi simple que cela.
16:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, néocons, néoconservateurs, donald trump, états-unis, deep state, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


